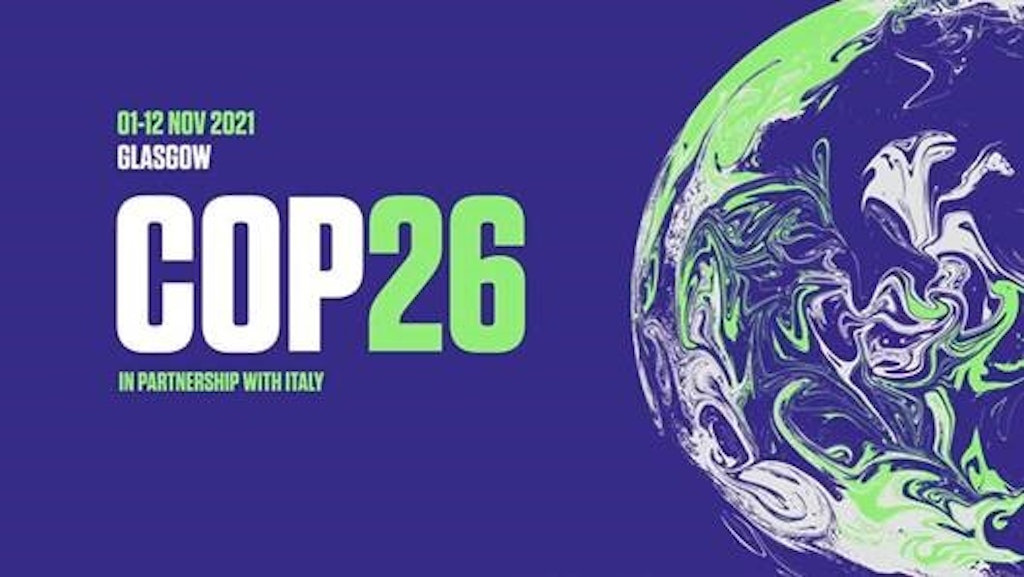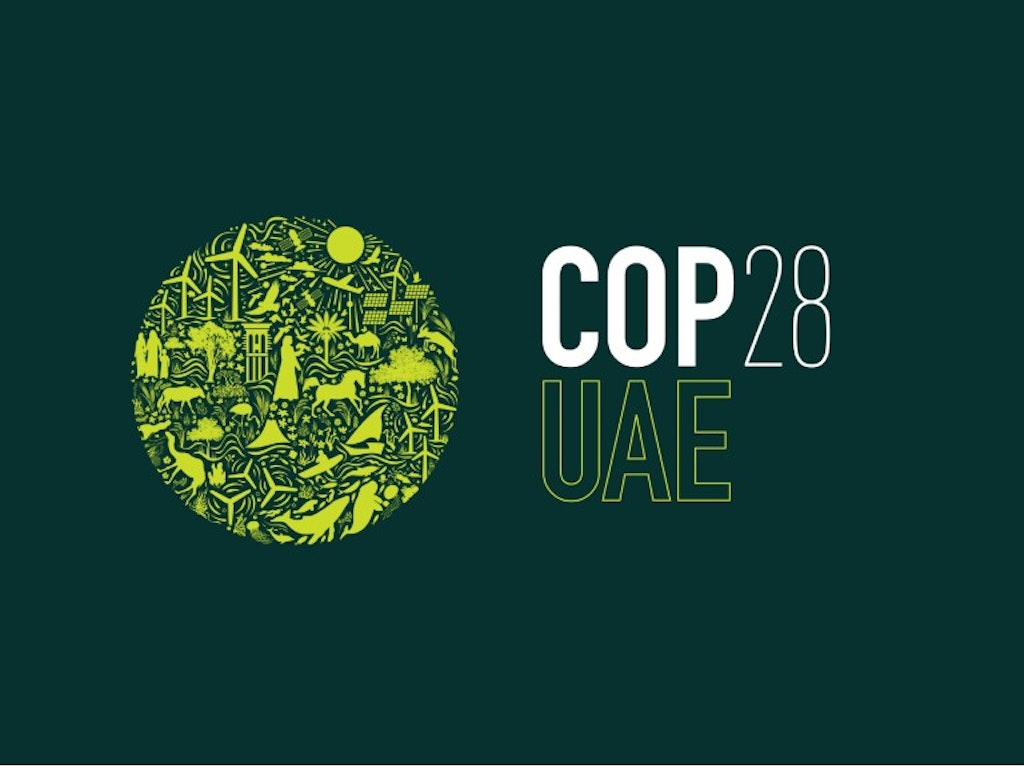Climat: Affaires internationales
Les gaz à effet de serre ne s'arrêtent pas aux frontières. La Suisse, avec son écosystème montagnard, est particulièrement vulnérable. Une action concertée au niveau mondial est décisive. C’est pourquoi la Suisse s'engage activement au niveau international pour la protection du climat.
Convention-cadre sur les changements climatiques
En 1992, la communauté internationale réunie à Rio de Janeiro reconnaît la nécessité d'une stratégie mondiale de protection du climat et adopte un premier accord international, la Convention-cadre sur les changements climatiques (CCNUCC). Les obligations au titre de la Convention ont depuis été largement supplantées par celles de l’Accord de Paris à partir de 2020.
Le Protocole de Kyoto
En 1997, la communauté internationale fixe des objectifs de réduction contraignants pour les pays industrialisés dans le Protocole de Kyoto. Après une première période d’engagement courant de 2008 à 2012, la Suisse et quelques autres pays reconduisent leurs engagements de réduction jusqu'en 2020 dans le cadre de la deuxième période d’engagement. L’Accord de Paris a succédé au Protocole de Kyoto pour la période après 2020.
L’Accord de Paris
Lors de la conférence sur le climat qui s’est tenue en 2015 à Paris, un accord, qui engage pour la première fois tous les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, a été adopté pour la période après 2020. L’ancienne distinction entre pays industrialisés et pays en développement a ainsi été largement supprimée.
Article 6 Ambition Alliance (AAA6)
Le 21 novembre 2025 à Belém, durant la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP 30), un group des pays a lancé l’ « Article 6 Ambition Alliance ». Cette alliance vise à réduire l’écart entre les contributions déterminées au niveau national (CDN) actuelles et les objectifs de température de l’Accord de Paris.
Accords bilatéraux sur le climat
En ratifiant l’Accord de Paris (accord sur le climat), la Suisse s’est engagée à réduire de 50 %, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990 (contribution déterminée au niveau national). Cet objectif doit en partie être atteint avec des projets de protection du climat réalisés à l’étranger. Une telle coopération bi- ou plurilatérale est possible en vertu de l’art. 6.2 de l’accord sur le climat. Dans ce contexte, la Suisse conclut des accords bilatéraux. Ces accords régissent les conditions-cadres de la coopération et définissent les exigences pour la reconnaissance, entre les Parties, des transferts des réductions d’émissions. Ainsi, les accords établissent le cadre juridique pour les contrats commerciaux conclus entre le vendeur et l’acheteur des réductions réalisées. Les pays et les acteurs intéressés peuvent contacter l’Office fédéral de l’environnement à l’adresse suivante : carbonoffset@bafu.admin.ch. Les projets autorisés selon les accords bilatéraux sont détaillés sur la page suivante :
Soumissions de la Suisse à la CCNUCC concernant les négociations internationales sur le climat
La Suisse œuvre activement en faveur d’un régime climatique global, propre à assurer des réductions suffisantes des gaz à effet de serre et à soutenir les pays en développement dans leurs efforts d’adaptation aux changements climatiques. Chaque partie peut faire part de sa position et de ses propositions dans une soumission, qui est intégrée dans le processus de négociations de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
Verdict de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la protection du climat
Lors de sa séance du 28 août 2024, le Conseil fédéral s’est penché sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire des Aînées pour le climat. Il souscrit à l’adhésion de la Suisse au Conseil de l’Europe et au système de la Convention européenne des droits de l’homme. Comme le Conseil national et le Conseil des États, il se montre toutefois critique quant à l’interprétation de la CEDH en ce qui concerne la protection du climat. Il estime en outre que la Suisse satisfait aux exigences de l’arrêt en matière de politique climatique.
1. Objectifs climatiques de la Suisse au titre de l’Accord de Paris (Nationally Determined Contribution, NDC)
L’accord sur le climat engage tous les États à prendre des mesures concrètes pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement mondial à 1,5 °C. Tous les cinq ans, les États sont tenus de renforcer leur objectif de réduction. Ils doivent également adopter des mesures permettant de l’atteindre et rendre compte des progrès réalisés. Le dernier objectif climatique de la Suisse à l'horizon 2030 a été soumis en 2017. Lors de sa séance du 29 janvier 2025, le Conseil fédéral a entériné le nouvel objectif suisse de réduction des gaz à effet de serre, qui concerne la période allant de 2031 à 2035.
Cet objectif s’inscrit dans la trajectoire de réduction fixée par la loi sur le climat et l’innovation (LCl). D’ici 2035, notre pays doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 65 % par rapport à leur niveau de 1990, et de 59 % en moyenne entre 2031 et 2035. Les mesures visant à atteindre les objectifs doivent être mises en œuvre en priorité sur le territoire national. Dans le même temps, le Conseil fédéral a adopté un complément à la Stratégie climatique à long terme de la Suisse.
Communication suisse (NDC 2031-2035):
Annex to the NDC: Contributions to the Global Stocktake:
Communication suisse (NDC 2021-2030):
Complement to the long-term climate strategy:
Les objectifs de réduction d’émission de la Suisse au plan national sont détaillés sur la page suivante :
Objectifs et stratégies de la politique climatique
La Suisse a communiqué à l’international ses objectifs de réduction d’émission. La contribution volontaire déterminée au niveau national est disponible sur le registre du Secrétariat de la CCNUCC :
2. Politique climatique internationale: étapes et résultats
Rio, Kyoto, Marrakech, Cancún, Paris : autant d’étapes dans les discussions sur la protection du climat. Depuis l'adoption de la Convention-cadre sur les changements climatiques, en 1992, la communauté internationale se réunit régulièrement aux fins de limiter les changements climatiques. La section ci-dessous détaille l’évolution du régime climatique à l’international.
En 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio, les pays adoptent la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), qui entrera en vigueur en 1994.
L’adoption de la CCNUCC constitue la première étape d'une action concertée sur le plan international. La Convention reconnaît officiellement l’importance des changements climatiques, et ses causes anthropiques liées aux émissions de gaz à effet de serre. La Convention vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui éviterait toute perturbation dangereuse du climat. Elle prend en considération la responsabilité différenciée des pays développés et des pays en développement, en prônant « une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique ». Elle encourage donc les gouvernements à mettre en œuvre des stratégies de réduction des émissions et d’adaptation au changement climatique, avec un soutien financier et technologique des pays développés aux pays en voir de développement et aux pays émergents. Les pays industrialisés s'engagent donc à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à aider les pays en développement à réduire leurs émissions et à s'adapter aux changements climatiques, notamment en finançant des projets dans le cadre du Fonds pour l'environnement mondial (FEM). La CCNUCC est aujourd’hui universelle, ratifiée par 195 Etats et l’Union européenne.
En 1997, à la COP3, les pays adoptent le protocole de Kyoto. Il s’agit du premier accord international contraignant sur des engagements chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il entre en vigueur en 2005, au moment où 55 pays, qui totalisaient 55 % des émissions mondiales de CO2 en 1990, l’ont ratifié. Sous le Protocole de Kyoto, les pays industrialisés s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2 % en moyenne par rapport à 1990 pour la période allant de 2008 à 2012, appelée première période d'engagement. Individuellement, ces objectifs contraignants vont de – 8 % à + 10 % d’émissions (8 % pour la Suisse et l'UE) par rapport à 1990. Les engagements pris dans le cadre de ce protocole sont contraignants mais ne couvrent que quelque 25 % des émissions mondiales. En effet, ils ne s’appliquent qu’aux pays développés – les pays en développement ayant uniquement l’obligation de dresser un inventaire d’émissions polluantes. Le protocole ne contraint donc pas des pays comme la Chine, l’Inde ou le Brésil. La Suisse a satisfait à ses obligations de réduction des émissions sous le Protocole de Kyoto dans la période 2008-12.
Fin 2012, lors de la Conférence sur le climat de Doha, les États conviennent d'une deuxième période d'engagement sous le Protocole de Kyoto (amendement de Doha). Par-là, les pays industrialisés s'engagent à réduire leurs émissions, d'ici à 2020, de 18 % en moyenne par rapport au niveau de 1990 (Suisse: moins 20% en 2020; UE: moins 20% entre 2013-2020). La deuxième période d'engagement ne concerne plus que 14 % des émissions mondiales, car outre les États-Unis et le Canada qui ont quitté le Protocole de Kyoto ou ne l’ont pas ratifié, désormais aussi le Japon, la Russie et la Nouvelle-Zélande n'ont plus aucune obligation pour la deuxième période d’engagement. Les pays en développement, pour lesquels il n'existe aucun engagement de réduction, ont quant à eux vu leurs émissions augmenter fortement. La 2e période d’engagement s’étend jusqu’en 2020. Une troisième période d’engagement n’est pas prévue.
En 2015, les pays adoptent l’Accord de Paris. Celui-ci est entré en vigueur le 4 novembre 2016 et prend effet à partir du 1er janvier 2021. Il couvre ainsi la période après 2020. L’Accord de Paris est la première convention internationale sur le climat contraignante pour tous les États : les pays développés et les pays en développement. En la ratifiant, les États s'engagent à prendre des mesures concrètes pour réduire leurs émissions et s'adapter aux changements climatiques en fonction de leurs responsabilités et capacités respectives. Les pays industrialisés réitèrent leur engagement à soutenir les pays en développement dans leurs efforts de réduction des gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. D'autres États sont désormais également invités à apporter ce soutien.
Dans le cadre de l’Accord de Paris, tous les grands émetteurs, y compris les États-Unis et la Chine, se sont engagés pour la première fois à atteindre des objectifs concrets de réduction des émissions. Au 1er mai 2020, 189 États avaient ratifié l’Accord de Paris, soit les États responsables de près de 97% des émissions globales de gaz à effet de serre. Sous la Présidence de Donald Trump, les États-Unis quittont l’Accord de Paris à la fin de 2020, avant de le rejoindre à nouveau sous la présidence de Joe Biden en février 2021. Le 20 janvier 2025, l’administration de Donald Trump annonce à nouveau que les États-Unis quittent l’Accord de Paris.
Chaque année ont lieu les conférences des États parties à la convention (COP), au Protocole de Kyoto (CMP) et à l’Accord de Paris (CMA). Lors de ces conférences, les États examinent les progrès effectués et prennent les décisions nécessaires à la mise en oeuvre effective de ces accords, y compris par exemple en s’accordant sur des règles plus détaillées permettant l’application des accords, ou encore sur des dispositions institutionnelles et administratives nécessaires.
2015, COP21 à Paris, France
2021, COP26 à Glasgow, Royaume-Uni
2022, COP27 à Charm el-Cheikh, Egypte
2023, COP28 à Dubaï, Émirats arabes unis
2024, COP29 à Baku, Azerbaïdjan
29e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP29) à Baku
3. Marché carbone au titre de l’Accord de Paris
3.1 Nouveaux mécanismes de marché
3.1.1 Accords de mise en œuvre de l'Article 6 de l'Accord de Paris
Les émissions de gaz à effet de serre ne connaissent pas de frontière. Aussi, les réductions d’émission ont le même effet, qu’elles soient réalisées en Suisse ou à l’étranger. L'engagement de la Suisse dans le cadre de l'Accord de Paris se traduit par une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins moins 50 % en 2030 par rapport aux niveaux de 1990 (Nationally Determined Contribution, NDC). L'Accord de Paris ancre, par son article 6.2, la coopération bi- ou plurilatérale dans la réalisation de la NDC. À cette fin, la Suisse conclut des accords bilatéraux.
Accords de mise en œuvre de l'Article 6 de l'Accord de Paris
3.1.2 Projets pilotes sur les nouveaux mécanismes de marché
La Suisse entend atteindre son objectif de réduction des gaz à effet de serre pour 2030 en partie grâce à des réductions à l'étranger. L’Accord de Paris prévoit de nouveaux mécanismes de marché pour permettre aux États d’acheter des réductions d'émissions à l’étranger et de comptabiliser ses réductions par rapport à ses propres objectifs climatiques. Les règles en la matière ont été déterminées au niveau international. La Suisse et la Fondation Centime Climatique développent des projets pilotes pour tester les nouvelles approches et élaborer des solutions pratiques pour l'après 2020.
3.2. Financement international dans le domaine du climat
Le financement international dans le domaine du climat représente une composante essentielle de la politique climatique internationale de la Suisse. C’est pourquoi celle-ci s’engage activement en faveur de ce thème dans les négociations internationales liées à la CCNUCC. La Suisse prône, dans le cadre de la convention et au-delà, des solutions pragmatiques aux différents défis relevant du financement climatique international, par exemple des instruments visant à stimuler la mobilisation de fonds privés et des méthodes pour calculer ces derniers. Elle entend apporter une contribution proportionnée au financement international dans le domaine du climat ainsi qu’aux différents fonds climatiques existants.
Les deux entités opérationnelles du mécanisme de financement de la CCNUCC sont le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le Fonds vert pour le climat (Green Climate Fund, GCF), auxquels la Suisse contribue.
Il existe en outre trois autres fonds liés à la CCNUCC :
- Le Fonds pour les pays les moins avancés (Fonds pour les PMA), institué en 2001, est l’un des mécanismes de financement de la CCNUCC. Il répond aux besoins spécifiques des pays les moins avancés, principalement les pays africains les plus pauvres ainsi que les petits États insulaires, qui sont particulièrement touchés par les changements climatiques et en subissent de plein fouet les effets négatifs. Le Fonds pour les PMA finance essentiellement des programmes nationaux d’adaptation aux changements climatiques.
- Le Fonds spécial pour les changements climatiques (Special Climate Change Fund, SCCF), institué en 2001, est un autre mécanisme de financement de la CCNUCC. Il fournit aux pays en développement et en transition des moyens supplémentaires en vue du financement des mesures de protection du climat prévues par la convention. Il soutient également, mais dans une moindre mesure, la promotion du transfert de technologies.
- Le Fonds d’adaptation (FA) a été institué en 2001 à titre de mécanisme de financement dans le cadre du Protocole de Kyoto afin de financer des projets et programmes d’adaptation aux changements climatiques dans les pays en développement. Il doit principalement être alimenté par des moyens financiers provenant du mécanisme pour un développement propre prévu par le protocole. Chaque projet bénéficiaire est soumis à une taxe de 4 %, dont la moitié des recettes est versée au FA. Lors de la COP qui s’est tenue en 2018 à Katowice, les Parties ont décidé que ce fonds devait également servir à la mise en œuvre de l’Accord de Paris et être alimenté par les moyens tirés des mécanismes de l’art. 6, al. 4, de l’accord.
Financement international dans le domaine de l’environnement
4. Alliances et coalitions dans les négociations climatiques
Dans le contexte des négociations et discussions internationales sur le climat, la Suisse n’agit pas seule, elle s’engage aux côtés d’autres pays. Elle est notamment active dans plusieurs groupes, alliances, et coalitions. La section ci-dessous détaille, de manière non exhaustive, quelques-uns de ces groupes.
4.1 Groupe d’intégrité environnementale (Environmental Integrity Group, EIG)
La Suisse s’engage dans les négociations climatiques internationales au sein du Groupe d’intégrité environnementale (Environmental Integrity Group, EIG), qu’elle préside. Composé en outre de la Géorgie, du Liechtenstein, de Monaco, du Mexique, de la Corée du Sud, et de la Suisse, l’EIG a été mis sur pied pendant les discussions sur le Protocole de Kyoto, durant lesquelles seuls des groupes de Parties étaient habilités à négocier. Ne faisant partie d’aucun groupe, la Corée du Sud, le Mexique et la Suisse ont décidé de créer l’EIG et ont invité d’autres Parties indépendantes à les rejoindre. Ce groupe est un fervent défenseur des politiques climatiques progressistes. En outre, il a une portée unique, car il couvre trois continents et trois fuseaux horaires et constitue le seul groupe à comporter à la fois des pays développés et des pays en développement. Le groupe a pour objectif de jouer un rôle constructif et peut aider à trouver un terrain d’entente entre deux blocs présentant des intérêts divergents.
4.2 Dialogue de Carthagène (Cartagena Dialogue)
Les négociations relatives à la CCNUCC ont été marquées par une certaine division entre pays en développement et pays industrialisés. Le Dialogue de Carthagène pour l’action progressive a été mis sur pied pour offrir un espace de discussion informel aux délégations des pays en développement et aux pays industrialisés afin de leur permettre d’examiner des pistes sortant du cadre des positions traditionnelles des groupes. Il constitue donc un groupe informel de pays s’engageant en faveur d’un régime ambitieux, global et contraignant à l’aune de l’Accord de Paris et entendant devenir ou rester des économies à faibles émissions de carbone. Sous son égide, des experts travaillent toute l’année à la recherche de solutions à différents problèmes rencontrés lors des négociations et se rencontrent physiquement lors de celles-ci. La Suisse est un membre actif du Dialogue de Carthagène, dont elle co-dirige un groupe de travail sur l’ambition en matière de réduction d’émission.
5. Base scientifique: le GIEC
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) afin d’obtenir des informations scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques d’origine anthropique.
Le GIEC procède régulièrement à une analyse des causes et des conséquences des changements climatiques et fournit ainsi les informations et bases de décision nécessaires à la politique climatique, sans pour autant livrer de recommandations politiques. Ses rapports périodiques constituent actuellement la base commune de tous les milieux qui sont concernés par la gestion des changements climatiques : experts, administrations ou économie privée. Le GIEC publie en outre tous les sept ans un rapport d’évaluation global sur les changements climatiques.
Le Bureau du GIEC a pour mission de conseiller cet organisme en matière de science et de stratégie de travail. Il est élu pour la durée d'un cycle de rapport de 5 à 7 ans. La candidate suisse, la professeure Sonia Seneviratne (EPFZ), a été élue au bureau du GIEC en juillet 2023 pour le septième cycle 2023-2030.
Présentant toujours la même structure, ces rapports se composent de quatre volumes. Les trois premiers sont constitués de rapports des trois groupes de travail du GIEC et le quatrième, d’une synthèse.
- Bases physiques des changements climatiques
- Incidences, adaptation et vulnérabilité
- Atténuation des changements climatiques
- Rapport de synthèse
Au cours de son septième cycle, le GIEC rédigera également un rapport spécial sur le changement climatique en milieu urbain, ainsi que deux rapports méthodologiques sur les facteurs climatiques à courte durée de vie et sur les technologies de captage du CO2, ainsi que sur le captage, l'utilisation et le stockage du CO2.
Des résumés de chaque rapport sont élaborés àl’intention des décideurs et approuvés par les États.
Rapport de synthèse
Le 20 mars 2023, en Suisse, à Interlaken, l'adoption du rapport de synthèse a marqué la fin du sixième cycle d'évaluation depuis la convocation du GIEC. Le rapport de synthèse résume l'état des connaissances sur les changements climatiques, leurs effets et risques généralisés ainsi que les opportunités d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre et de s’adapter aux impacts des changements climatiques. Le rapport de synthèse se fonde sur les contributions déjà publiées par les trois groupes de travail et trois rapports spéciaux. Le rapport examine l'état actuel et les tendances, présente les prévisions climatiques à long terme et évalue les options de réponse aux changements climatiques.
Atténuation des changements climatiques
En avril 2022, le GIEC a publié le troisième volume de son sixième rapport d’évaluation. Il y dresse le tableau des émissions de gaz à effet de serre mondiales et du réchauffement climatique en plusieurs scénarios. Il montre les mesures de protection du climat à prendre afin de maintenir l’élévation des températures mondiales d’ici à la fin du siècle en dessous de 1,5 °C. Ces mesures englobent notamment les énergies renouvelables, les mesures d’efficacité énergétique ainsi que les carburants de substitution durables. Les émissions difficilement évitables doivent être compensées au moyen de technologiques qui extraient le CO2 de l’atmosphère et le stockent (aussi appelées technologies d’émission négative). À cette fin, le rapport présente non seulement les coûts, mais aussi les avantages économiques des mesures politiques de protection du climat.
IPCC: 6th Assessment Report - Mitigation of Climate Change
Incidences, adaptation et vulnérabilité
Fin février 2022, le GIEC a publié le deuxième volume de son sixième rapport d'évaluation. Il y montre la vulnérabilité de la nature et de la société face aux risques inhérents aux changements climatiques. En outre, il évalue les stratégies d’adaptation actuelles et possibles à l’avenir. La publication confirme qu’il existe à cet égard d’importantes différences selon les régions considérées. Elle montre que l’Europe doit agir pour réduire les risques inhérents aux changements climatiques et rendre l’environnement et la société plus résilients face aux effets de ceux-ci.
IPCC: 6th Assessment Report - Impacts, Adaptation and Vulnerability
Bases physiques des changements climatiques
Le GIEC a publié le premier volume de son sixième rapport d’évaluation en août 2021. Cette publication confirme les conclusions des rapports précédents du GIEC, à savoir la contribution des gaz à effet de serre d’origine anthropique au réchauffement planétaire ainsi que le lien entre changements climatiques et hausse de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les canicules, les fortes précipitations et les périodes de sécheresse.
IPCC: 6th Assessment Report - The Physical Science Basis
Rapports spéciaux du GIEC
Le GIEC a publié en 2014 son cinquième rapport d’évaluation. En 2018, il a adopté le Rapport spécial sur la stabilisation de la température globale à 1,5 degré au-dessus du niveau préindustriel. En 2019, deux autres rapports spéciaux sont parus : un sur les océans ainsi que la cryosphère et un autre sur les écosystèmes terrestres.
IPCC: 6th Assessment Report - Special Reports
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change