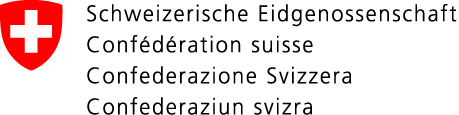Biotopes d’importance nationale
De nombreux habitats autrefois répandus n’existent plus que sous une forme fortement réduite. Afin de préserver la diversité des habitats et des espèces rares et menacées qui les peuplent, les zones alluviales, les marais, les sites de reproduction de batraciens et les prairies et pâturages secs sont protégés via les inventaires des biotopes d’importance nationale.
Les habitats abritent des espèces particulières qui se sont adaptées aux conditions qui y règnent. Tout changement de la qualité du site risque d’entraîner la perte de ces espèces spécialisées. Demeurent alors les « généralistes » largement répandus, rejoints par des espèces nouvelles. L’habitat d’origine et les espèces spécifiques qui lui sont liées disparaissent et les fonctions de l’écosystème se perdent.
 mauvais
mauvais
 négative
négative
S’agissant des marais, la valeur en nutriments n’a pas évolué entre la première période (2012-2017) et la deuxième période (2018-2023) de relevés réalisés dans le cadre du Suivi des effets de la protection des biotopes en Suisse. Pour ce qui est des prairies et des pâturages secs (PPS), elle a baissé de manière significative. Cette évolution positive des PPS reflète les succès de la gestion de la protection de la nature (p. ex. augmentation des zones tampons pour les nutriments, exploitation conforme aux exigences de protection). De même, les mesures de protection de l’air pourraient avoir favorisé l’évolution positive de la végétation typique des PPS, adaptée à des conditions trophiques pauvres.
Dans les marais comme dans les PPS, les relevés ont montré une baisse des valeurs d’humidité. Les marais continuent donc de s’assécher. Cette tendance avait déjà été constatée lors du projet précédent de suivi des effets de la protection des marais (1998-2006). En revanche, dans les PPS, la sécheresse croissante peut être considérée comme plutôt positive.
Les valeurs de luminosité ont diminué de manière significative dans les hauts-marais et les PPS, et ont également tendance à reculer dans les bas-marais (signification marginale). Une baisse de la valeur de luminosité témoigne de conditions plus ombragées, qui peuvent être dues à l’accroissement de la couverture ligneuse. Dans les PPS et les bas-marais, cet accroissement pourrait être le résultat d’une sous-exploitation, voire à d’un abandon de l’exploitation. Dans les hauts-marais, qui ne sont pas exploités, la baisse d’humidité pourrait favoriser l’augmentation de la couverture ligneuse et donc entraîner des conditions plus ombragées.
Si les PPS présentent des évolutions positives, la qualité écologique des marais a continué à se dégrader. L’objectif étant d’éviter toute perte de qualité et d’améliorer celle des milieux menacés, l’état et l’évolution sont jugés négatifs.
Depuis 2012, les changements survenus dans les biotopes d’importance nationale sont recensés dans le cadre du Suivi des effets de la protection des biotopes en Suisse, qui est assuré par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Des relevés effectués sur le terrain et des analyses de vues aériennes permettent de contrôler si les biotopes évoluent conformément aux objectifs de protection.
Pour déterminer les modifications de la végétation dans les marais, les PPS et les zones alluviales d’importance nationale, des échantillons ont été prélevés dans des objets des inventaires correspondants, puis pondérés de sorte à représenter adéquatement les régions (biogéographiques), les types de végétation ainsi que les différentes grandeurs et altitudes des objets.
Le premier relevé a été achevé en 2017 et le deuxième, en 2023. Pour ce qui est des PPS, des relevés de végétation ont été effectués dans 441 objets, sur un total de 2149 surfaces d’observation permanentes de 10 m2. Quant aux marais, les analyses ont porté sur 665 surfaces d’observation permanente dans 86 bas-marais, et sur 428 surfaces d’observation permanente dans 59 hauts-marais. Étant donné que les données ont été collectées à deux reprises sur chaque surface d’observation permanente, c’est-à-dire lors du premier relevé comme du deuxième, la puissance statistique des tests est grande. Cette méthode permet de détecter à temps les changements insidieux.
Sur les surfaces d’observation permanente, les espèces de plantes et leur degré de couverture ont été déterminés sur le terrain. Pour chaque espèce, il existe des valeurs indicatrices écologiques qui montrent dans quelle mesure l’espèce réagit à certaines conditions environementales. Sur la base des moyennes de ces valeurs, on déduit les conditions trophiques, d’humidité et de luminosité de chaque objet et on vérifie si les différences entre les premier et deuxième relevés sont statistiquement significatives.
L’évaluation se base sur les différences significatives des valeurs indicatrices moyennes (valeurs en nutriments, d'humidité, de luminosité) de tous les types de biotopes conformément aux résultats du Suivi des effets de la protection des biotopes. Voir Résultats du suivi des effets de la protection des biotopes – Rapport condensé (PDF, 3 MB, 30.06.2025).
Informations complémentaires