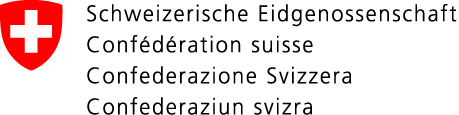Immissions de dioxyde d'azote
Le terme « oxydes d’azote » (NOx) recouvre aussi bien le dioxyde d’azote (NO2) que le monoxyde d’azote (NO). Ces composés sont produits lors de la combustion de carburants et de combustibles, surtout lorsque celle-ci se fait à haute température. Le trafic automobile est la première source d’oxydes d’azote. Les oxydes d’azote sont des précurseurs importants des pluies acides, des aérosols secondaires et, lorsqu’ils se combinent à des composés organiques volatils, des photooxydants (ozone, smog estival). Associés à l’ammoniac, ils créent des poussières fines et contribuent à l’eutrophisation des écosystèmes. Le dioxyde d’azote (NO2) et d’autres gaz irritants favorisent par ailleurs les maladies des voies respiratoires, particulièrement chez les enfants.
 bon
bon
 positive
positive
Les valeurs limites d'immissions de NO2 sont aujourd'hui respectées dans toutes les stations NABEL. Les valeurs mesurées sont plus élevées en ville, en milieu périurbain et dans les zones à fort trafic, qu'en milieu rural. Depuis le milieu des années 1980, la charge en NO2 a diminué d'environ 50 %, grâce à des mesures comme l’abaissement des valeurs limites applicables aux effluents gazeux ou l’obligation de monter un pot catalytique sur les véhicules individuels. Néanmoins, la pollution par les oxydes d'azote reste un problème sérieux qui affecte de vastes régions de la Suisse. Les valeurs sont toujours supérieures aux lignes directrices recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la protection de la santé humaine (NOx = 10µg/m3). Pour cette raison, des mesures de réduction supplémentaires sont nécessaires, par exemple l'application des meilleures technologies disponibles pour les véhicules, les installations industrielles et agricoles ou les générateurs de chaleur.
- Indicateurs associés
- Apport excessif d'azote dans des écosystèmes sensibles
- Emissions d'oxydes d'azote
Les États membres de l’Union européenne mesurent également les immissions de dioxyde d’azote et calculent le même indicateur. Le charge en dioxyde d’azote est plus faible en Suisse que dans les pays voisins (moins de véhicules fonctionnant au diesel, pas de centrales thermiques) (AEE 2024).
L’évolution de la pollution atmosphérique dans l’ensemble de la Suisse est mesurée par le réseau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL). Ce réseau, géré par l’OFEV et l’Empa, comprend seize stations réparties dans toute la Suisse, qui effectuent des mesures là où la pollution est la plus importante. Pour l'évaluation des émissions de dioxyde d'azote, on a calculé la moyenne des données de mesure des stations pour les différents types de sites, en ne prenant en compte que les stations rurales de la rive nord des Alpes.
| Evolution visée | Valeur initiale | Valeur finale | Variation en % | Evolution observée | Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| Diminution | Moyenne 2000-2002 | Moyenne 2022-2024 | (1) -48.33%, (2) -47.05%, (3) -44.71%, (4) -41.10%, (5) -58.20% | (1) Diminution, (2) Diminution, (3) Diminution, (4) Diminution, (5) Diminution | positive |
| (1) milieu urbain à fort trafic, (2) milieu urbain, (3) milieu périurbain, (4) milieu rural, (5) Préalpes/Jura | |||||
Informations complémentaires