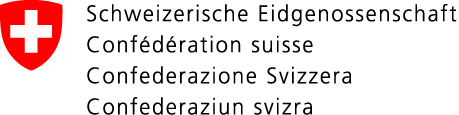Empreinte de l'impact environnemental global
L’indicateur couvre tous les domaines de l’environnement en mesurant l’impact global de la demande finale suisse dans notre pays et à l’étranger. Il englobe entre autres les matières premières et les ressources énergétiques nécessaires à la fabrication des biens de consommation, ainsi que les terres et les ressources hydriques utilisées pour l’habitat, les transports et l’alimentation humaine et animale. Si la surexploitation des ressources en Suisse n’affecte pas encore son système économique ni la qualité de vie de ses habitants (perspective attendue à moyen ou à long terme), d’autres pays sont déjà durement touchés, notamment par la déforestation, les changements climatiques ou la pénurie d’eau.
 mauvais
mauvais
 positive
positive
Entre 2000 et 2022, l’impact environnement global de la consommation suisse a baissé (en dépit de variations annuelles) en moyenne de 33 %, passant de 36 à 24 millions d’unités de charge écologique (UCE) par habitant. Du fait d’un accroissement démographique durant cette période, la diminution de l’impact en termes absolus a toutefois été plus faible (environ 18 %). Étant donné que nous importons de nombreux produits, l’impact environnement global de la consommation suisse se produit avant tout à l’étranger. En 2022, il a été généré à plus de 66 % à l’étranger.
Étant donné que la production de biens et services génère des atteintes à l’environnement, l’impact environnemental global devrait évoluer en fonction de la demande finale. Or ce n’est pas le cas : si la demande finale suisse a augmenté entre 2000 et 2021, l’impact environnement global s’est réduit. Nous observons donc un découplage entre le niveau de vie et l’impact environnemental global. Autrement dit, l’efficacité de l’impact environnement global s’est améliorée.
Ce découplage est par exemple dû aux succès de la protection de l’air et de la couche d’ozone en Suisse, notamment grâce aux prescriptions légales et aux évolutions technologiques. Les parts accrues de biens et services respectueux de l’environnement peuvent également y avoir contribué.
Cependant, l’impact environnemental global actuel est presque trois fois supérieur à la valeur limite d’une utilisation durable des ressources. Le calcul de cette valeur se fonde principalement sur les limites planétaires, les objectifs de la politique environnementale de la Suisse et une extrapolation de la consommation suisse à l’échelle planétaire.
La diminution de l’impact environnemental global enregistrée jusqu’à présent ne permet pas d’atteindre la valeur seuil pour 2030 ni, par conséquent, l’objectif d’utilisation durable des ressources de l’Agenda 2030. De plus, les efforts fournis ne couvrent pas tous les domaines de l’environnement. C’est pourquoi l’état est jugé mauvais.
L’indicateur exprimé en unités de charge écologique se réfère aux objectifs de la politique environnementale de la Suisse.Une comparaison internationale est impossible. L’approche est toutefois reprise à des fins de débats scientifiques dans d’autres pays tels que l’Allemagne et le Japon.
Agrégation des différentes atteintes à l’environnement : l’évaluation de l’impact environnemental global exige l’agrégation en un indicateur de toutes les atteintes à l’environnement telles que les apports de polluants dans l’air et dans les eaux, les apports de métaux lourds dans les sols, la consommation de matières premières, etc. Dans le présent exemple, nous avons utilisé la méthode de la saturation écologique (méthode UCE), qui exprime toutes les atteintes environnementales en unités de charge écologique (UCE). Cette méthode pondère au moyen d’écofacteurs les différentes atteintes à l’environnement en fonction de l’écart entre la situation environnementale actuelle (émissions et utilisation des ressources) et les objectifs d’un État ou d’une région (approche de la distance par rapport à l’objectif). En Suisse, la méthode UCE se base sur les connaissances scientifiques qui servent à déterminer les niveaux d’émissions actuelles et les objectifs environnementaux suisses et internationaux qui sont adoptés par le parlement et le gouvernement. Plus l’écart entre le niveau des émissions actuelles annuelles et les valeurs limites inscrites dans la législation est grand, plus la valeur de l’écofacteur est grande. L’ampleur de l’atteinte environnementale, mesurée en éco-points, dépend donc de cet écart, car elle est déterminée par la multiplication de la quantité des émissions étudiées avec l’écofacteur correspondant.
Perspective de l’empreinte environnementale : afin de modéliser l’impact environnemental de la demande finale, l’intégralité de la chaîne de valeur ajoutée de tous les biens et services consommés est prise en compte, à savoir l’ensemble de la charge environnementale occasionnée par l’extraction, la production, le transport, l’utilisation et l’élimination. Le calcul inclut les ressources utilisées et les émissions générées en Suisse et à l’étranger. L’impact dû aux exportations est soustrait puisqu’il n’est pas imputable à la consommation suisse. Cet indicateur repose sur les limites de système de la perspective de l’empreinte environnementale, à savoir de la consommation.
Le calcul de l’indicateur est tiré de la publication Empreintes environnementales de la Suisse. Évolution entre 2000 et 2018 (EBP/Treeze 2022) et de l'actualisation suivante.
Comparaison avec l’empreinte écologique: L’indicateur est apparenté à l’indicateur empreinte écologique du Global Footprint Network, mais les deux ne doivent pas être confondus. Ce dernier agrège l’utilisation directe du sol, la pêche de poissons sauvages et la surface forestière nécessaire à la compensation des émissions de CO2 fossiles (en théorie) requises pour satisfaire les besoins de la consommation. L’empreinte écologique n’est pas un indicateur environnemental global. La consommation d’eau douce et d’autres ressources naturelles renouvelables et non renouvelables de même que les pertes de biodiversité ou les atteintes environnementales dues aux polluants atmosphériques, aux métaux lourds, à l’azote et aux polluants difficilement dégradables ne sont pas prises en compte. Son intérêt tient à sa clarté et à sa très grande notoriété. L’empreinte écologique de la Suisse extrapolée à l’échelle planétaire est presque trois fois supérieure à la biocapacité mondiale. En dépit de leurs différences, les méthodes de l’empreinte écologique et de la saturation écologique aboutissent à des conclusions similaires concernant le besoin d'agir.
| Evolution visée | Valeur initiale | Valeur finale | Variation en % | Evolution observée | Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| Diminution | Moyenne 2000-2002 | Moyenne 2020-2022 | -31.32% | Diminution | positive |
| Base: Total des empreintes par habitant | |||||
Informations complémentaires