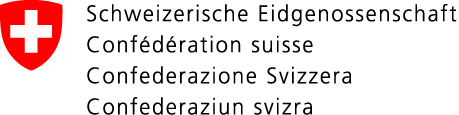Comment les différents dangers environnementaux sont-ils appréhendés par la population ? De quelle manière cette perception influe-t-elle sur les comportements des uns et des autres ? Explications.
Texte : Erik Freudenreich
Avalanches, crues, tremblements de terre : la Suisse n’est pas épargnée par les dangers environnementaux. Ainsi, au cours des cinquante dernières années, les dommages causés par des événements naturels ont atteint en moyenne 304 millions de francs par an, selon les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Les crues d’août 2005 ont provoqué à elles seules des dégâts records pour un montant de 3,2 milliards de francs. Des événements qui pourraient augmenter tant en fréquence qu’en intensité en raison des changements climatiques, mais qui pourraient aussi toucher des régions du pays épargnées jusque-là.
Climat et dangers naturels

Une enquête réalisée l’an dernier par l’OFS indique que 41 % des personnes sondées disent percevoir des changements climatiques importants en Suisse, 48 % des changements légers et 11 % aucun changement. Paradoxalement, ces observations ne se reflètent pas forcément dans les comportements des personnes interrogées, par exemple en matière de consommation d’énergie ou d’achat d’appareils électriques, relèvent les auteurs de l’étude.
« Certaines personnes minimisent l’impact sur les humains du changement climatique, ce qui peut influencer leur perception des risques et leur volonté de prendre des mesures de précaution. De manière générale, la conscience des risques varie considérablement en fonction des expériences personnelles et des contextes sociétaux, explique Elisabeth Maidl, sociologue et autrice de différentes études sur le sujet. Par exemple, les personnes vivant dans des zones déjà touchées par des catastrophes naturelles ont tendance à avoir une conscience des risques plus élevée. Cependant, cette relation n’est pas linéaire et d’autres facteurs comme la possibilité d’influencer les événements, la confiance dans les autorités, et le degré d’engagement social jouent également un rôle crucial. »
Dans les zones alpines, la conscience des risques est aussi souvent plus marquée en raison des expériences transmises de génération en génération. « À l’inverse, dans les zones urbaines comme le Plateau, où la densité de population et les infrastructures sont plus importantes, cette conscience est moins présente, même si les dommages potentiels y sont plus élevés. » La relation entre la conscience du risque et le comportement préventif n’est toutefois pas linéaire. L’expérience personnelle et le sentiment d’efficacité personnelle constituent d’autres facteurs clés de la motivation à prendre des mesures de précaution. La possibilité d’influer sur les effets des événements joue également un rôle, tout comme la confiance dans les autorités et les forces d’intervention et le degré d’engagement social. « Les personnes qui participent activement à la vie de la communauté peuvent également mieux situer les risques liés aux dangers naturels dans le contexte local. Les connaissances, les opinions et les attitudes locales sont en outre fortement influencées par l’environnement social. Les comprendre et s’y référer facilite la communication et peut avoir un effet décisif sur l’acceptation des interventions. »
Impacts en cascade
S’y ajoute le fait que les changements climatiques provoquent des situations complexes, en cascade, note Stéphane Losey, chef de la section Glissements de terrain, avalanches et forêts protectrices au sein de l’OFEV. « C’est particulièrement vrai en montagne, où par exemple un glissement de terrain dû au réchauffement du pergélisol peut ensuite impacter plusieurs autres processus. » Une collaboration entre les scientifiques, les autorités locales et la population est essentielle pour développer des stratégies efficaces face à des phénomènes imprévisibles et intenses. De plus, une bonne communication avec la population est importante afin que les personnes soient sensibilisées et préparées à ce qui peut se passer.
La population suisse montre une grande confiance dans les autorités, ce qui facilite la communication sur les risques anciens et nouveaux. Cependant, cela entraîne également des attentes élevées en termes de protection et de gestion des risques. « Les autorités doivent donc maintenir un dialogue constant et ouvert avec la population pour assurer une compréhension et une acceptation mutuelles des mesures prises », dit Elisabeth Maidl. Des initiatives comme la création de cartes de dangers participatives peuvent aider à impliquer les habitants et à renforcer la culture de la sécurité.
Communication bidirectionnelle
L’an dernier, la vie dans le village de Brienz (GR) a été bouleversée : près de 1,2 million de mètres cubes de roches se sont détachés de la montagne qui surplombe la localité. 84 personnes ont dû être évacuées à titre préventif. Une galerie de drainage est prévue pour ralentir le glissement du village, mais l’incertitude géologique persiste, créant une ambiance d’anxiété constante pour les habitants. Une hot-line a été mise en place par les autorités pour canaliser les demandes et diffuser des informations. Elle a enregistré plusieurs centaines d’appels au plus fort de la crise, y compris de nombreuses personnes solidaires de toute la Suisse offrant des solutions d’hébergement. L’outil a joué un rôle crucial dans le soutien psychosocial, en écoutant les préoccupations des habitants et en dirigeant les appels vers les personnes compétentes, explique Jürg Maguth, psychothérapeute et responsable de la hot-line. « Elle a été un outil précieux de médiation pour résoudre les conflits et empêcher l’escalade des tensions psychosociales. De plus, elle a servi de point de contact entre le comité de direction communal et la population, assurant une circulation bidirectionnelle de l’information. »
Malgré la gravité de la situation, les habitants semblent avoir développé une forme de résilience. Ils ont appris à vivre avec le danger, adoptant une approche pragmatique, souligne Jürg Maguth. « Par exemple, les agriculteurs continuent de travailler leurs champs malgré les ravins et fissures qui apparaissent soudainement. »
La commune envisage de maintenir la hot-line jusqu’à ce que la situation se stabilise. Le succès de cette approche a conduit d’autres communes à envisager de mettre en place des systèmes similaires de manière proactive. « Cela a aussi montré l’importance d’une approche intégrée, combinant expertise technique et soutien psychosocial », conclut Jürg Maguth.
la 5g, entre craintes et avantages concrets

Comment l’acceptation de cette nouvelle technologie de téléphonie mobile a-t-elle évolué au cours du temps ?
En 2019, l’introduction de la technologie 5G en Suisse a suscité un vif débat public. Certains y voyaient une avancée technologique essentielle, tandis que d’autres craignaient des effets sanitaires et environnementaux potentiels.
Une étude de l’Institut de psychologie de l’Université de Zurich a identifié plusieurs facteurs clés influençant la perception des risques liés à la 5G. « La confiance dans les autorités de régulation est importante : plus celle-ci est faible, plus la perception du risque est élevée, explique Clara Balsiger, collaboratrice scientifique au sein de la section Rayonnement non ionisant (RNI) à l’OFEV. De même, les personnes se considérant comme électrohypersensibles perçoivent un risque plus élevé. À l’inverse, une meilleure connaissance objective de la 5G est associée à une perception du risque réduite. »
Valeurs limites contre le rayonnement
L’effet du rayonnement de la téléphonie mobile sur l’humain dépend de sa fréquence et de son intensité. La 5G utilise actuellement des fréquences déjà employées pour la téléphonie mobile et les réseaux sans fil. Il existe un certain nombre d’études qui abordent la question des effets sanitaires ou biologiques dans ces gammes de fréquences. Certains effets sont bien connus et avérés, tels que la capacité de réchauffer un corps ou les parties d’un corps. « La législation protège la population contre ces effets liés au rayonnement issu d’antennes de téléphonie mobile, dont les antennes 5G. Elle fixe des valeurs limites d’immissions qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent se trouver. »
En dessous de ces limites, certains effets biologiques ont été observés, mais les éléments disponibles ne permettent pas d’affirmer qu’il existe un risque pour la santé. « La Suisse applique donc le principe de précaution en limitant davantage l’exposition de la population au rayonnement non ionisant (RNI) dans les lieux où les personnes séjournent régulièrement (p. ex. logements, écoles, hôpitaux) », explique Clara Balsiger. Ce principe de précaution, inscrit dans la loi sur la protection de l’environnement, est concrétisé par les valeurs limites préventives dans l’ordonnance sur la protection contre le RNI (ORNI). Ces valeurs limites préventives visent donc à limiter toute atteinte potentiellement nuisible et sont, pour la téléphonie mobile, dix fois plus basses que les valeurs limites d’immissions. Le Conseil fédéral a confirmé qu’il n’entendait actuellement pas modifier ces valeurs limites en réponse aux préoccupations liées à la 5G.
Mesures d’accompagnement
L’OFEV suit de près les avancées de la recherche sur les effets potentiels du rayonnement non ionisant (RNI). Il a notamment créé un groupe consultatif d’experts en matière de RNI (BERENIS) pour examiner et évaluer les nouveaux travaux scientifiques.
En plus, plusieurs mesures ont été lancées pour accompagner l’introduction de la 5G. « L’OFEV encourage la recherche sur les effets du RNI, finançant actuellement plusieurs projets interdisciplinaires, indique Clara Balsiger. L’Institut de médecine de famille de l’Université de Fribourg a mis en place, sur mandat de l’OFEV, le Réseau suisse de conseil médical sur le RNI (MedNIS), actif depuis septembre 2023, pour aider les personnes qui se considèrent électrosensibles. »
Un monitoring périodique de l’exposition au RNI a également été instauré. Depuis 2021, des mesures sont effectuées dans toute la Suisse dans des espaces publics extérieurs et intérieurs typiques, ainsi que dans des habitations privées. Les résultats montrent une exposition modérée et respectant les bases légales de protection de la santé.
Enfin, pour renforcer l’information et la sensibilisation de la population, l’OFEV, l’Office fédéral de la communication et l’Office fédéral de la santé publique ont développé un site internet dédié, qui vise à répondre aux principales questions sur la téléphonie mobile et la 5G.
Informations complémentaires
Dernière modification 25.09.2024