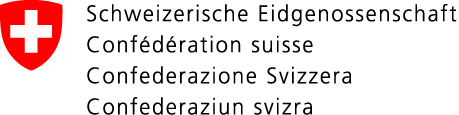À l’heure actuelle, il est pratiquement impossible d’identifier les plantes issues des nouvelles techniques de sélection génétique. L’OFEV a chargé le laboratoire cantonal de Bâle-Ville de découvrir s’il est possible de concevoir des méthodes de détection.
Texte : Christian Schmidt et Nicolas Gattlen

© Kilian Kessler | Ex-Press | BAFU
Le bruissement d’ailes des pigeons, devant les grandes fenêtres, se fait de plus en plus perceptible : il l’est d’autant plus que Claudia Bagutti et Melanie Schirrmann, installées dans la bibliothèque du laboratoire cantonal de Bâle-Ville (KLBS), réfléchissent en silence à des questions auxquelles personne n’a encore trouvé de réponse.
Claudia Bagutti est directrice du laboratoire de sécurité biologique ; Melanie Schirrmann est sa plus proche collaboratrice. Jusqu’à récemment, c’est-à-dire jusqu’au développement, en 2012, des « ciseaux génétiques » baptisés CRISPR/Cas, le travail des deux femmes était réglé comme du papier à musique. Il s’agissait, entre autres, de contrôler la présence de modifications génétiques classiques dans de la luzerne ou du colza (voir graphique, article «Une petite coupe qui suscite de grands débats») prélevés dans les ports ou les gares. Ces plantes étaient issues de semences, le plus souvent importées d’outre-Atlantique sous forme d’impuretés dans du blé dur et disséminées à l’air libre durant le transport. S’il était prouvé que du matériel génétique étranger avait été inséré dans les plantes, celles-ci devaient être détruites, conformément à la réglementation. La palette des modifications génétiques possibles était connue, ce qui permettait aux institutions concernées – à l’instar du KLBS – de développer des méthodes fiables pour les détecter. Le résultat était, lui aussi, sans ambiguïté : soit les plantes étaient génétiquement modifiées, soit elles ne l’étaient pas.
Une aiguille dans une botte de foin
Cette époque est désormais révolue. La recherche a ouvert de nouvelles voies pour intervenir sur le génome des êtres vivants. Les technologies de genome editing, ou édition du génome (voir graphique, article «Une petite coupe qui suscite de grands débats»), offrent un tel potentiel pour le développement de nouveaux produits que la recherche évoque une possible « révolution agricole ». Or ce sont justement ces techniques qui donnent actuellement du fil à retordre à Claudia Bagutti et Melanie Schirrmann. La raison : à la demande de l’OFEV, le KLBS doit établir s’il est possible de mettre au point des méthodes de détection des plantes ainsi modifiées, ce qui permettrait de contrôler leur entrée en Suisse. L’OFEV a choisi ce laboratoire en raison de son expérience de près de 20 ans dans le développement de méthodes d’analyses des organismes génétiquement modifiés (OGM).
Mais comment identifier des modifications génétiques totalement inconnues ? À la différence de l’Union européenne (UE) et de la Suisse, de nombreux pays comme les États-Unis et le Canada ne considèrent pas les plantes issues de l’édition génomique comme des OGM. Elles ne sont par conséquent soumises à aucune obligation d’étiquetage et de traçabilité. Comme les entreprises nord-américaines ne sont donc pas contraintes d’indiquer les modifications génétiques, cette quête revient à chercher une aiguille dans une botte de foin : on sait qu’elle existe, mais il est extrêmement difficile de la trouver.
Mutations naturelles ou artificielles ?
« Contrairement au génie génétique classique, les interventions exécutées dans le cadre de l’édition génomique ne sont pas identifiables », explique Claudia Bagutti. « En effet, il est impossible de différencier ces modifications volontaires des mutations qui se produisent naturellement dans chaque plante. Malgré leurs répercussions souvent importantes, les modifications génétiques apportées sont si infimes qu’elles se perdent dans le volume des modifications naturelles. » Selon la directrice du laboratoire, les méthodes d’analyse utilisées jusqu’à présent ne permettent pas de mettre en évidence les interventions artificielles, et il n’existe aucune piste concrète dans ce sens.
Claudia Bagutti et Melanie Schirrmann font face aux mêmes problèmes que leurs collègues œuvrant dans les laboratoires de référence de l’UE, avec lesquels elles collaborent d’ailleurs étroitement. Les spécialistes déterminent combien de plantes issues de l’édition génomique sont autorisées et classées comme « organismes non génétiquement modifiés » rien qu’aux États-Unis (ils en ont actuellement répertorié environ 70, du maïs plus riche en amidon jusqu’aux pommes et aux champignons qui ne brunissent pas, en passant par le colza résistant aux herbicides). Ils observent le marché nord-américain et se préparent déjà à ce qu’un jour ces plantes arrivent dans l’UE et en Suisse sous forme d’impuretés dans des importations agricoles. Par ailleurs, ils cherchent des méthodes qui permettraient de les identifier. En vain jusqu’à aujourd’hui : « Tout le monde est sur le qui-vive », observe Claudia Bagutti.
L’espoir subsiste
La rencontre dans le laboratoire cantonal se transforme alors en discussion autour des opportunités et des risques de la biologie moléculaire moderne – plus précisément autour de la question de savoir pourquoi les grands groupes agricoles d’outre-Atlantique ne sont pas soumis à l’obligation de déclarer où et comment ils interviennent sur le matériel génétique quand ils pratiquent le genome editing (dans le cas des modifications génétiques courantes jusqu’à présent, les producteurs de semences ont dû développer des méthodes de détection en conséquence). Il est ainsi difficile pour les pouvoirs publics de l’UE et de la Suisse d’assumer leurs responsabilités en tant qu’organes de contrôle.
Cependant, l’espoir subsiste, car des esprits ingénieux ont toujours réussi à résoudre ce qui paraissait insoluble. En témoignent les portraits qui trônent fièrement dans la cage d’escalier du laboratoire cantonal : les anciens chimistes cantonaux de Bâle-Ville, avec leurs barbes soignées, ont dû venir à bout d’épiciers frauduleux qui mélangeaient de la farine de maïs ou de millet bon marché à la farine blanche. Ils ont eu à confondre des paysans qui vendaient de manière illicite du lait écrémé ou dilué à l’eau. Après la catastrophe de Tchernobyl, leurs successeurs ont été confrontés au défi de protéger la population des denrées alimentaires contaminées. « Et, lorsque le génie génétique est apparu, nous ne savions pas comment nous y prendre pour déceler les OGM. Il s’agissait d’un énorme défi. Or cette détection fait aujourd’hui partie de la routine », explique Claudia Bagutti.
Un superordinateur à la rescousse ?
Claudia Bagutti compte donc sur l’évolution technologique future. Une évolution qui est notamment liée à la puissance de calcul des ordinateurs et à l’étroite collaboration entre les différents organes de contrôle : « Les appareils capables d’analyser, sur un temps relativement court, des milliards de paires de bases permettront peut-être de distinguer les mutations naturelles des mutations apportées par l’être humain sur le génome d’une plante. Mais, en guise de contrôle, il faudrait disposer à cet effet d’une base de données incluant l’ensemble des végétaux ’ corrigés ’ et ’ non corrigés ’, ce qu’une institution ne pourrait pas mettre en œuvre à elle seule. »
Séparer les flux de marchandises dès le départ
Actuellement, il n’est pas possible d’identifier en laboratoire les plantes obtenues par édition génomique. « Ce n’est qu’en sachant sur quelle petite partie du génome les modifications ont été apportées qu’on peut les reconnaître », affirme Markus Hardegger, chef du secteur Ressources génétiques et technologies à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Selon lui, même en l’absence de méthodes de détection fiables et précises, il est toutefois possible d’assurer la séparation du flux des marchandises et de garantir la liberté de choix – pour autant que les informations à cet égard soient accessibles au public. Markus Hardegger évoque des situations similaires dans le cas d’autres labels : « De nombreux labels ou critères de labellisation, à l’instar des labels bio ou fairtrade, ne peuvent pas, à ce jour, être contrôlés par des analyses. Mais si les informations relatives à l’édition génomique sont disponibles au début de la chaîne, chaque label peut conserver sa crédibilité en assurant la séparation du flux des marchandises. »
Informations complémentaires
Dernière modification 29.05.2019