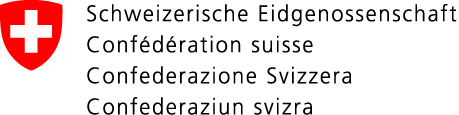Les matières plastiques n’ont rien à faire dans l’environnement. Pourtant, près de 14 000 tonnes de matières plastiques sont rejetées chaque année dans les sols et les eaux en Suisse – principalement du fait de l’abrasion et de la dégradation d’éléments en plastique ainsi que de l’élimination inappropriée de déchets. Étant donné que les matières plastiques se dégradent très lentement dans l’environnement et que les concentrations vont augmenter avec le temps, il convient d’appliquer le principe de précaution et d'en réduire au minimum les rejets dans l’environnement.

- Un matériau polyvalent aux multiples impacts environnementaux
- Macroplastiques et microplastiques
- Voies d’apport des matières plastiques dans l’environnement
- Recherches nécessaires sur les matières plastiques dans l’environnement
- État actuel des connaissances résumé pour le grand public
- Réduire autant que possible les apports de matières plastiques dans l’environnement
- Engagement au niveau international
- Regard vers l’Europe : stratégie de l’UE sur les matières plastiques
Un matériau polyvalent aux multiples impacts environnementaux
Chaque année, 1 million de tonnes de matières plastiques sont utilisées en Suisse pour fabriquer aussi bien des produits qui ont une durée d’utilisation très longue, comme des cadres de fenêtre ou des pièces de carrosserie de voiture, que des produits à courte durée de vie, tels des emballages ou de la vaisselle. Environ 790 000 tonnes de matières plastiques par an sont soit valorisées thermiquement, dans les usines d’incinération des ordures ménagères et les cimenteries, soit réintroduites dans le cycle des matières en étant recyclées et réutilisées.
En raison de leur polyvalence et de leur stabilité, les matières plastiques sont présentes partout dans le monde : dans les océans, la glace de l’Arctique, les montagnes, les sols, les cours d’eau, les lacs, les sédiments, l’air et même dans le tube digestif des êtres vivants. De plus, une multitude d’additifs est libérée par les différents types de matières plastiques.
Pour mesurer l’ampleur de la pollution de l’environnement par les matières plastiques, il est important de faire la distinction entre macroplastiques et microplastiques. Suivant la grandeur des particules, les sources, les voies d’apport dans l’environnement ainsi que les conséquences possibles pour les êtres vivants sont très différentes. Cette distinction donne des indications sur les mesures de réduction envisageables.
Macroplastiques et microplastiques
Les particules de plastiques de plus de 5 mm et les déchets plastiques sont appelés macroplastiques, tandis que les particules inférieures à 5 mm, à peine visibles à l'œil nu, sont nommées microplastiques. Ces derniers peuvent être divisés en microplastiques primaires et secondaires.
Les microplastiques primaires sont des particules dont la fabrication est voulue pour être ajoutées à des produits (p. ex. granulés de remplissage pour terrains en gazon synthétique, engrais, produits phytosanitaires, cosmétiques, nettoyants ménagers et industriels, couleurs et laques).
Les microplastiques secondaires se forment pendant l’utilisation et l’élimination de produits en plastique (p. ex. abrasion des pneus, abrasion des fibres textiles synthétiques due au lavage ou processus de broyage) ou lors de la dégradation des macroplastiques en microplastiques.
Voies d’apport des matières plastiques dans l’environnement
Sur la base de données disponibles provenant d’études pour la Suisse, l’OFEV estime que, chaque année, environ 14 000 tonnes de macroplastiques et de microplastiques sont rejetées dans les sols, les eaux de surface et leurs sédiments. La plus grande partie de cet apport de matières plastiques provient de l’abrasion des pneus (env. 8900 tonnes), suivie du littering (env. 2700 tonnes) et de nombreuses autres sources. Le diagramme ci-dessous présente les flux de matières des principales sources, des mécanismes de rétention, de l’élimination et des puits de matières plastiques dans l’environnement.
Références du diagramme des flux de matières
A Estimations de l’OFEV concernant l’apport de microplastiques dans les océans par les cours d’eau suisses sur la base de l’étude suivante :
B
C
D Kawecki, Delphine; Livnat Goldberg, et Bernd Nowack (2021). Material flow analysis of plastic in organic waste in Switzerland. Soil Use and Management (en anglais).
E Sur la base des études suivantes :
Steiner, Michele (2020). Mikroplastik: Eintrag von Reifenabrieb in Oberflächengewässer (PDF, 1 MB, 21.06.2020)Sur mandat de l'OFEV (en allemand)
Steiner, Michele (2022). Priorisierung von Massnahmen zur Reduktion des Eintrags von Reifenabrieb in Oberflächengewässer. Sur mandat de l’OFEV. Rapport non encore publié.
F Patrick, Michael, Ann-Kathrin Stalder, Cengiz Akandil, Patricia Meier, et Michael Burkhardt (2022). Erhebung von Kunststoffrasenflächen und Mikroplastik in der Schweiz (KUNST). Sur mandat de l’OFEV. Rapport non encore publié.
Informations complémentaires
- Les connaissances sur les émissions et les apports de matières plastiques dans l’environnement suisse ne cessent de progresser grâce à des projets de recherche. À titre d’exemple, il ressort de récents travaux que 500 tonnes d’apports de matières plastiques dans l’environnement viennent s’ajouter aux flux de matières décrits ci-dessus (voir Liu, Zipeng et Bernd Nowack (2022). Probabilistic material flow analysis and emissions modeling for five commodity plastics (PUR, ABS, PA, PC, and PMMA) as macroplastics and microplastics. Resources, Conservation and Recycling). Les polymères faisant l’objet de cette étude ne peuvent toutefois pas être attribués de façon univoque aux différentes sources présentées dans le diagramme.
- Abrasion des pneus : Les résidus d’abrasion des pneus se composent de trois groupes de substances (matières plastiques, matières de remplissage et substances inorganiques) ; aussi, la part de microplastiques purs représente 60 % de l’ensemble des particules issues de l’abrasion des pneus.
- Ménages : Comprennent comme sources l’abrasion de fibres lors du lavage de textiles synthétiques, les microplastiques dans les cosmétiques ainsi que les matières plastiques éliminées de manière inappropriée dans les toilettes tels que les produits hygiéniques.
Principales sources d’émission (en haut dans le diagramme des flux de matières)
Les macroplastiques parviennent essentiellement dans l’environnement à la suite d'une élimination inappropriée de déchets plastiques (p. ex. littering, matières plastiques dans les déchets verts collectés). Les microplastiques sont majoritairement dus à l’abrasion et à la dégradation des produits en plastique (p. ex. abrasion des pneus) sous forme de microplastiques secondaires. Si les microplastiques ajoutés intentionnellement dans des produits (cosmétiques) et ceux provenant de l’usure des textiles synthétiques lors du lavage représentent une faible par des apports totaux dans l’environnement, ils constituent cependant des apports significatifs dans les eaux de surface.
Mécanismes de rétention et élimination (au milieu dans le diagramme des flux de matières)
Une série de mesures existantes (p. ex. épuration des eaux usées, élimination des déchets, nettoyage des routes) permettent de réduire considérablement l’apport de matières plastiques dans l’environnement. En Suisse, la gestion des déchets urbains et des eaux usées ainsi que les services communaux contribuent donc de façon substantielle à éviter que des matières plastiques soient rejetées dans l’environnement. Ces mesures de nettoyage et ces mécanismes de rétention ne permettent toutefois pas d’intercepter la totalité des émissions : les déchets abandonnés (littering) ou les résidus de l’abrasion des pneus, par exemple, parviennent sous la forme d’apports diffus dans les eaux et les sols par ruissellement des eaux de pluie ou par dispersion dans l’air.
Puits (en bas dans le diagramme des flux de matières)
Les matières plastiques rejetées dans l’environnement restent durablement dans les puits, c’est-à-dire dans les sédiments des lacs et des cours d’eau et dans les sols. Selon l’état actuel des connaissances, en Suisse, les apports de matières plastiques sur les sols et dans ceux-ci sont plus élevés que dans les eaux de surface. La pollution des océans par les micro- et les macroplastiques constitue un problème supplémentaire, d’ampleur internationale.
Recherches nécessaires sur les matières plastiques dans l’environnement
En raison de la complexité des flux des matières plastiques dans l’environnement, les connaissances sont insuffisantes dans plusieurs domaines. Des travaux de recherche d’envergure sont nécessaires pour combler les lacunes dans les domaines suivants :
- apport de matières plastiques dans l’environnement ;
- maintien, comportement et dégradation des matières plastiques dans l’environnement ;
- impact des matières plastiques (y c. additifs) sur les êtres vivants et les écosystèmes
Certaines données existent dans ces trois domaines, mais sont souvent grevées de grandes incertitudes et se révèlent difficiles à comparer et à interpréter en raison de méthodologies et d’unités différentes. Une méthode de mesure adaptée à la pratique doit être développée pour les très petites particules (p. ex. résidus d’abrasion des pneus), car celles-ci ne peuvent pas être décelées avec les méthodes existantes.
État actuel des connaissances résumé pour le grand public
Le rapport « Matières plastiques dans l’environnement » en réponse aux postulats Thorens Goumaz (18.3196), Munz (18.3496), Flach (19.3818) et Groupe PDC (19.4355) présente une vue d’ensemble sur le sujet (état : été 2022). Il décrit dans une première partie le cycle de vie des plastiques, de la fabrication à l’élimination. Il expose également les sources, les voies d’apport et les puits principaux des matières plastiques dans l’environnement ainsi que les effets de celles-ci sur l’environnement et la santé. Dans une seconde partie, le rapport présente les mesures déjà mises en œuvre et les mesures en cours ainsi que les potentiels d’amélioration à exploiter.
L’OFEV a résumé les connaissances actuelles sur les thèmes principaux de cette problématique dans dix fiches d’information « Matières plastiques dans l’environnement » (état : printemps 2020).
Les matières plastiques dans l’environnement: Cours d’eau et lacs (PDF, 144 kB, 12.05.2020)Fiche n° 1
Les matières plastiques dans l’environnement: Êtres humains et animaux (PDF, 78 kB, 12.05.2020)Fiche n° 5
Les matières plastiques dans l’environnement: Abrasion des pneus (PDF, 146 kB, 12.05.2020)Fiche n° 6
Les matières plastiques dans l’environnement: Emballages plastiques (PDF, 119 kB, 12.05.2020)Fiche n° 8
Réduire autant que possible les apports de matières plastiques dans l’environnement
Les matières plastiques ne se dégradent guère dans l’environnement, ou seulement à très long terme, voire au bout de plusieurs siècles. Étant donné qu'elles s’accumulent dans l’environnement, leurs apports doivent être réduits autant que possible en vertu du principe de précaution.

© BAFU
Les mesures urgentes visant à réduire l’impact environnemental des matières plastiques font l’objet de discussions en Suisse comme à l’étranger. Preuve en est le nombre important d’interventions politiques sur cette problématique qui sont actuellement examinées au Parlement et traitées par l’administration. Des potentiels d’amélioration sont présentés dans Ie rapport « Matières plastiques dans l’environnement » en réponse aux postulats Thorens Goumaz (18.3196), Munz (18.3496), Flach (19.3818) et Groupe PDC (19.4355). Avec la motion 18.3712 « Réduire la pollution plastique dans les eaux et les sols », déposée par la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national et adoptée par le Parlement, la Confédération est chargée d’examiner et de prendre des mesures, avec les branches concernées, afin de lutter efficacement contre les atteintes à l’environnement dues aux matières plastiques en adoptant une approche globale et en tenant compte des principales sources d’émission.
Engagement au niveau international
Une part notable de la charge environnementale due aux matières plastiques est générée lors de la production primaire, qui se déroule majoritairement à l’étranger. Or les problèmes globaux ne peuvent être résolus que collectivement. En conséquence, l’OFEV plaide également au niveau international en faveur d’une gestion durable des matières plastiques et s’engage en ce sens dans les instances compétentes.
En mars 2022, l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (ANUE) a décidé d’entamer des négociations en vue d’un accord juridiquement contraignant sur les matières plastiques. L’accord a pour objectif de combattre la charge environnementale due aux plastiques tout au long du cycle de vie de ces derniers. Les négociations ont débuté en 2022 et le Comité intergouvernemental de négociation chargé d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique (Intergovernmental Negotiating Committee INC) s’est déjà réuni cinq fois sans toutefois parvenir à conclure un accord en 2024 comme prévu initialement. Par conséquent, les négociations se poursuivent avec la rencontre INC-5.2 à Genève en août 2025. La Suisse s’engage en faveur d’un accord efficace. Elle est membre d'une coalition à cette fin (High Ambition Coalition). Cette coalition interétatique s’engage à ce que toute trace de plastiques dans l’environnement soit éliminée d'ici à 2040 au moyen de l’accord.
Informations complémentaires concernant l’accord sur les matières plastiques : Négociations pour l’élaboration d’un accord sur les matières plastiques (en anglais) et «High Ambition Coalition to End Plastic Pollution» (en anglais)
Par ailleurs, la Suisse est Partie à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Lors de la conférence des Parties à la Convention de Bâle en mai 2019, la délégation suisse a soutenu activement le fait que les déchets plastiques mixtes soient soumis à un contrôle depuis début 2021. Tous les États concernés (États d’exportation, de transit et d’importation) doivent donner leur accord préalable aux mouvements transfrontières prévus. Informations complémentaires sur la mise en œuvre des nouvelles règles suisses : Mouvements transfrontières de déchets (valable pour la Principauté du Liechtenstein et la Suisse)
Dans le cadre de la Convention de Bâle, un partenariat public-privé sur les déchets plastiques a été mis en place (Plastic Waste Partnership, en anglais) afin de mobiliser les ressources, les intérêts et l’expertise des entreprises, du gouvernement, de la communauté scientifique et de la société civile pour améliorer la gestion des déchets plastiques et, si possible, prévenir leur production.
Regard vers l’Europe : stratégie de l’UE sur les matières plastiques
En 2015, l’Union européenne (UE) a publié un premier plan d’action pour l’économie circulaire, dont les matières plastiques constituent l’un des cinq champs d’action prioritaires. La stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire (ci-après stratégie de l’UE sur les matières plastiques) a suivi en 2018. Les mesures qu’elle esquisse visent à diminuer la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de matières premières fossiles ainsi qu’à réduire les émissions de CO2.
En 2019, la directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (ci-après directive sur les plastiques à usage unique) est venue concrétiser la stratégie de l’UE sur les matières plastiques et oblige les États membres à mettre en œuvre une série de mesures. D’une part, elle interdit certains produits (p. ex. matières plastiques oxo-dégradables, pailles et couverts en plastique à usage unique). D’autre part, elle prévoit des mesures de sensibilisation ainsi que des exigences en matière de marquage des produits (indication des voies correctes d’élimination), de responsabilité élargie des producteurs et de réduction de l’utilisation de certains produits en plastique à usage unique (p. ex. gobelets pour boissons). Les États membres de l’UE doivent inscrire des mesures en ce sens dans leurs législations nationales respectives.
En 2020, l’UE a publié un nouveau plan d’action pour l’économie circulaire, qui précise les mesures adoptées dans la stratégie. Ce plan propose, par exemple, une production durable, un plus grand soin dans le design des produits, une meilleure information des consommateurs, le renforcement du recyclage et de l’emploi de contenu recyclé.
Le Plan d’action de 2020 a entraîné l’adaptation ou le développement d’une série de directives et règlements. Le règlement (UE) 2025/40, entré en vigueur en février 2025, est pertinent pour les plastiques. Il fixe des exigences en matière d’emballages, notamment ceux en plastique. Dès 2030, les emballages doivent par exemple être conçus de façon à être recyclables et, à partir de 2035, ils doivent effectivement être recyclés. De plus, un contenu recyclé minimal est défini spécifiquement pour les emballages en plastique. Le règlement définit des buts à atteindre en matière d’utilisation d’emballages réutilisables et limite voire interdit l’emploi de certains emballages à usage unique (p. ex. certains emballages de portions individuelles dans la gastronomie ou l’hôtellerie).
La Suisse n’est pas tenue de respecter la directive sur les emballages à usage unique ni le règlement relatif aux emballages de l’UE. Toutefois, les entreprises qui exportent vers l’UE doivent tenir compte des réglementations de l’UE ainsi que de celles de chaque État membre. L’OFEV suit les travaux de l’UE et vérifie en permanence la pertinence d’adapter les règles suisses afin tant de renforcer la protection de l’environnement que de lever toute entrave au commerce.
Informations complémentaires sur les travaux de l’UE sur : Matières plastiques (en anglais)
Informations complémentaires
Liens
Documents
Clean Cycle Project Results: plastic material flows and hazardous chemicals in plastics (PDF, 1 MB, 17.03.2025)Commissioned by the FOEN
Kunststoffrasenflächen für Fussball: Qualität und Beurteilung des Sickerwassers (PDF, 4 MB, 25.09.2024)Studie im Auftrag des BAFU
Étude «IDHEAP: Comparing European and Swiss Strategies for the Regulation of Plastics» (PDF, 3 MB, 17.01.2022)Sur mandat de l'OFEV (en anglais, avec un résumé en allemand et en français
Le Plastique dans l'environnement Suisse (PDF, 1 MB, 15.04.2020)Etude sur mandat de l'OFEV
Étude «Mikroplastik: Eintrag von Reifenabrieb in Oberflächengewässer» (PDF, 1 MB, 21.06.2020)Sur mandat de l'OFEV (en allemand)
Étude «The Identity of Oxo-Degradable Plastics and their Use in Switzerland» (PDF, 2 MB, 31.03.2020)Sur mandat de l'OFEV (en anglais)
Article technique «Modellierung von Plastik in der Umwelt» (PDF, 1 MB, 05.05.2020)Article sur une étude mandatée par l'OFEV (en allemand avec un résumé en français)
Dernière modification 31.07.2025