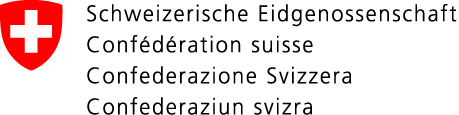L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) exploite un réseau d’observation national permettant de suivre le transport de sédiments par les cours d’eau. Le suivi consiste à mesurer la concentration de matières en suspension ainsi que la turbidité de l’eau et à relever les volumes de matériaux charriés qui s’accumulent dans des dépotoirs. Les données de ces relevés peuvent être commandées auprès de l’OFEV. Autrefois, on procédait également à des levés des deltas. Dans le cadre de projets pilotes, les matières en suspension font également l’objet d’investigations portant sur différents éléments chimiques et physiques, comme les métaux lourds et les microplastiques.

Qu’est-ce que le transport de sédiments ?
Par sédiments, on désigne toutes les matières solides qui sont transportées ou déposées dans l’eau. Dans les cours d’eau, on distingue trois formes de sédiments selon que les matières solides sont flottantes, en suspension ou charriées sur le fond. Les matières en suspension sont généralement la principale forme de sédiments dans un cours d’eau.
- Matières en suspension : les matières en suspension sont des particules fines et légères qui sont brassées dans l’eau et tenues en suspension. Elles peuvent être composées d’argile et de silt et parfois aussi, dans les rivières à plus forte pente et les torrents, se présenter sous la forme de sable. Dans les tronçons de cours d’eau à faible courant et dans les lacs, les matières en suspension se déposent sur le fond, où elles forment des couches de sédiments.
- Matériaux charriés : le charriage se compose de matériaux plus grossiers, comme du sable, du gravier, des pierres et même de gros blocs. Ces matériaux sont transportés sur le fond des cours d’eau par roulement, glissement ou rebond. Le phénomène concerne les cours d’eau avec une plus grande capacité de transport, par exemple avec un débit plus élevé (crue) ou une pente plus forte (ruisseaux de montagne).
- Matériaux flottants : les matériaux flottants sont principalement d’origine organique. Il s’agit notamment de plantes aquatiques, de morceaux de bois et de déchets plastiques flottant à la surface.
Le transport de sédiments est fréquemment augmenté en cas de crues, par exemple. En peu de temps, de grands volumes de matériaux peuvent être transportés vers des zones inondables. Dans certaines circonstances, le cours de l’eau peut s’en trouver modifié.
Messnetz des Bundes für den Transport suspendierter Sedimente in Fliessgewässern – Geschichte und zukünftige Entwicklung (PDF, 1 MB, 15.09.2025)Article de la revue « Eau énergie air » 1/2021
Betrieb des Bundes-Messnetzes für den Transport suspendierter Sedimente in Fliessgewässern (PDF, 3 MB, 15.09.2025)Article de la revue « Eau énergie air » 1/2021
Feststoffbeobachtung in der Schweiz
Cette publication n´existe pas en français. Elle est disponible dans d´autres langues. 2005
Importance du suivi du transport de sédiments
Les connaissances sur le transport de sédiments sont d’une importance majeure pour diverses raisons économiques et scientifiques.
- Protection des eaux et transport de polluants : les matières en suspension jouent un rôle important dans la qualité des eaux, car elles ont la capacité d’adsorber et d’accumuler de nombreuses substances polluantes et nocives, comme des métaux lourds ou des composés organiques. En transportant ces substances dans les eaux, elles contribuent à diffuser des pollutions. En ce sens, les matières en suspension agissent comme des réservoirs et – lorsqu’elles libèrent lentement les composés dans l’environnement – comme des sources secondaires d’atteintes durables à l’environnement. Connaître les propriétés physiques et chimiques de ces particules ainsi que leur charge en polluants est donc très important pour la protection de l’intégrité écologique des écosystèmes aquatiques et pour l’évaluation de la qualité des eaux.
- Protection des organismes aquatiques : les sédiments fins peuvent porter atteinte aux habitats aquatiques. Sur le fond des eaux, les interstices entre les particules grossières garantissent une bonne circulation de l’eau et offrent de petites niches aux espèces dites litho-rhéophiles. Ces conditions sont importantes pour la truite notamment, qui peut ainsi pondre ses œufs dans un gravier où l’eau est bien oxygénée. Lorsque les interstices entre les graviers sont comblés par des sédiments fins, les échanges entre le flux d’eau et le gravier sont entravés, si bien que les œufs de truite ne sont plus suffisamment alimentés en oxygène et peuvent mourir. Une quantité excessive de sédiments fins peut ainsi causer la perte d’un habitat essentiel aux espèces litho-rhéophiles, entraînant une importante mortalité du frai et un recul de la biodiversité. Par ailleurs, une forte concentration de matières en suspension dans l’eau a pour effet de diminuer la lumière incidente, ce qui réduit l’activité photosynthétique et donc la production primaire. Les algues et les plantes aquatiques se développent moins bien. En outre, les particules en suspension absorbent la chaleur, ce qui entraîne une augmentation de la température de l’eau. À des concentrations élevées, les matières en suspension peuvent aussi nuire aux invertébrés et aux poissons en obstruant leurs organes filtrants et respiratoires et en freinant le développement des œufs et des larves. Dans ce contexte, les particules fines sont plus nuisibles que les particules grossières. Afin de protéger la biodiversité aquatique, il est donc indispensable de contrôler la charge en suspension.
- Protection des eaux souterraines : les sédiments fins peuvent aussi nuire au renouvellement des ressources en eau souterraine. Le processus qui obstrue les interstices du substrat sur le fond de l’eau est appelé « colmatage du lit ». Il entrave les échanges entre le cours d’eau et les eaux souterraines et peut ainsi limiter le remplissage des aquifères. Une exploitation excessive des eaux souterraines entraînerait alors un abaissement de leur niveau. Cependant, les sédiments fins agissent aussi comme une couche filtrante qui retient les particules, les bactéries et certaines substances polluantes et les empêche de pénétrer dans les eaux souterraines.
- Protection des installations techniques et des infrastructures : le transport dynamique des sédiments peut constituer un risque majeur pour les infrastructures comme les ponts, les digues et les installations techniques. Un suivi spécifique permet de détecter suffisamment tôt les dangers tels que l’érosion et l’abrasion et de prendre des mesures de protection adaptées. Dans le cas d’une installation avec exploitation de réservoirs, le remplissage du bassin par des sédiments peut réduire la capacité de stockage et donc le volume d’eau disponible pour la production d’électricité. Étant donné que la production d’électricité en Suisse est d’origine hydraulique à 59,6 % (OFEN, 2024), la surveillance active de ces infrastructures par les exploitants est vitale. Pour protéger les turbines contre l’usure, il faut par ailleurs installer des filtres ou d’autres dispositifs techniques, comme des désableurs, dont l’action est commandée à l’aide des mesures de concentration et de répartition granulométrique des matières en suspension. Les données collectées grâce à l’observation des matières en suspension permettent ainsi de prévenir les dommages dus à l’usure et de garantir l’efficacité des installations à long terme.
- Atterrissement et navigation fluviale : les matières solides transportées vers les lacs s’y déposent et forment des deltas. À long terme, ce processus d’atterrissement naturel peut nuire à la navigation fluviale. Pour pouvoir maintenir les voies navigables ouvertes, il est essentiel de mesurer les volumes de sédiments transportés et déposés et, si besoin, d’entreprendre des travaux de dragage pour éliminer les obstacles à la navigation.
L’accumulation de matières solides dans les deltas représente par ailleurs un risque d’instabilité et de glissement, en particulier en cas de crue. Ces glissements peuvent causer des dommages considérables aux infrastructures. Le suivi des flux des matières en suspension est donc crucial pour garantir le développement des deltas et permettre l’évaluation des risques sur le long terme ainsi que la planification de mesures préventives.
- Évaluation de la stabilité, de l’érosion et des pertes de sol dans les bassins versants : les effets des changements climatiques (p. ex. périodes de sécheresse plus longues, précipitations plus intenses, retrait des glaciers, hausse des températures) entraînent une augmentation du taux d’érosion et de la perte de sol dans les bassins versants, ce qui peut avoir pour conséquence un transport accru de matières en suspension dans les cours d’eau. La mesure des matières en suspension et du charriage fournit des indications sur les processus d’érosion dans un bassin versant. Ces données permettent de comparer les taux d’érosion des bassins versants, mais aussi d’évaluer l’efficacité des mesures de lutte contre l’érosion.
Informations sur les réseaux d’observation
Observation des volumes de charriage
L’OFEV recense les volumes de charriage qui sont mesurés au niveau d’une centaine de dépotoirs. Ce sont les cantons et les instituts de recherche qui lui communiquent les volumes de matériaux charriés qui s’accumulent dans les dépotoirs. Ces volumes sont estimés à l’aide d’instruments topographiques ou lors de la vidange des dépotoirs.
Observation des matières en suspension
Le suivi du transport de matières en suspension a débuté dans les années 1960. Il sert à documenter l’état des eaux et leurs modifications à long terme et à contrôler l’efficacité de la législation sur la protection des eaux et de l’environnement.
Au fil des ans, les matières en suspension dans les cours d’eau ont été mesurées à 59 stations. Actuellement, les concentrations de matières en suspension sont observées à 14 stations de mesure réparties stratégiquement sur les principaux cours d’eau de Suisse, en amont des grands lacs. Les échantillons de matières en suspension sont prélevés deux fois par semaine au milieu du cours d’eau, à sa surface, à l’aide d’un échantillonneur développé par l’OFEV. En complément, le profil transversal du cours d’eau est décrit de manière détaillée une fois par an grâce à des échantillons verticaux de matières en suspension prélevés à différentes profondeurs. Cet échantillonnage multidimensionnel permet de déterminer la répartition des concentrations de matières en suspension sur la section transversale du cours d’eau.
Le flux annuel des matières en suspension est calculé d’après les concentrations mesurées, en tenant compte également des mesures de débit et de turbidité. Les analyses chimiques supplémentaires prévues dans les années à venir permettront une évaluation exhaustive de la pollution chimique et de la contamination des eaux. Cette évaluation comprendra également des investigations sur les métaux lourds et les polluants organiques persistants fortement hydrophobes (tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP), qui sont souvent transportés avec les matières en suspension. La taille des particules sera également déterminée (composition granulométrique). Les microplastiques et les résidus d’abrasion de pneumatiques comptent aussi parmi les matières en suspension.

© AWEL, Direction cantonale des travaux, Zurich/Police cantonale, Zurich
Observation de la turbidité
La mesure de la turbidité dans les cours d’eau (réduction de la transparence) est entre autres utilisée pour estimer la concentration de matières en suspension, en particulier entre les prises d’échantillons. Toutefois, la turbidité n’est pas une grandeur spécifique de la concentration de matières en suspension, et la corrélation entre les deux valeurs n’est pas toujours linéaire, car elle dépend aussi des propriétés optiques des matières en suspension mesurées (p. ex. coefficient de réfraction, forme, autres propriétés).
Les quatorze stations de l’OFEV servant à la mesure des matières en suspension sont équipées de sondes optiques qui enregistrent la turbidité en continu à l’aide d’un procédé néphélométrique : les sondes émettent un faisceau lumineux dans l’eau environnante, puis mesurent la part de lumière qui leur revient après sa diffusion par les particules présentes dans l’eau. L’intensité de la lumière diffusée revenant frapper la fenêtre de la sonde est une mesure de la concentration de particules dans l’eau. Pour des plages de concentration différentes, la sonde peut mesurer la lumière diffusée à différents angles par rapport au rayon lumineux émis (90° et 140° pour des concentrations plus élevées).
Profileur acoustique des flux sédimentaires
Les mesures optiques de la turbidité dépendent fortement de la taille des particules en suspension. Généralement, la répartition granulométrique des matières en suspension n’est pas uniforme et elle peut varier rapidement en fonction des conditions d’écoulement et des conditions dans le bassin versant. Utiliser la mesure de la turbidité comme une variable d’entrée continue pour le calcul des flux des matières en suspension est donc une méthode comportant certaines incertitudes. Afin d’améliorer le réseau de mesure des matières en suspension et de réduire les incertitudes, l’OFEV a chargé l’Université technique de Vienne de perfectionner et d’optimiser le système existant. La solution étudiée est une technologie de mesure hydroacoustique, dont l’élément central est un profileur acoustique des flux sédimentaires (ASFP) qui mesure en continu la concentration de matières en suspension, la taille des particules et la vitesse d’écoulement sur toute la section transversale du cours d’eau. L’ASFP devrait améliorer considérablement la précision et la résolution temporelle des mesures, mieux repérer les événements tels que les précipitations intenses et réduire à long terme les prélèvements d’échantillons réalisés manuellement ainsi que les analyses en laboratoire.

Levés des deltas et de fonds des lacs
S’il est important d’observer l’évolution des deltas à l’embouchure des lacs, c’est parce que le phénomène peut avoir des effets non seulement sur le cours d’eau (modification de la morphologie, atténuation de la pente) mais également sur le lac (envasement, modification de la biosphère, production d’eau potable). En règle générale, l’OFEV ne réalise plus de levé des deltas ni des fonds de lac. Les données bathymétriques demeurent toutefois disponibles dans le modèle numérique de terrain swissBATHY3D, qui restitue avec précision la topographie du fond des lacs suisses.
Documents
Die Mengenmässige Erfassung von Schwebstoffen und Geschiebefrachten (PDF, 9 MB, 22.03.2013)GHO Mitteilung Nr. 2
Empfehlung zur Abschätzung von Feststofffrachten in Wildbächen I (PDF, 3 MB, 26.05.2009)GHO Mitteilung Nr. 4
Empfehlung zur Abschätzung von Feststofffrachten in Wildbächen II (PDF, 13 MB, 26.05.2009)GHO Mitteilung Nr. 4
Geschiebelieferung alpiner Wildbachsysteme bei Grossereignissen (PDF, 9 MB, 02.06.2009)Ereignisanalysen und Entwicklung eines Abschätzverfahrens. Dissertation von Eva Gertsch, Universität Bern, 2009.
Feststoffverlagerung in steilen Fliessgewässern (PDF, 4 MB, 26.05.2009)GHO Mitteilung Nr. 5
Anhänge zur Dissertation von Eva Gertsch (PDF, 20 MB, 02.06.2009)Factsheets zu den untersuchten Wildbacheinzugsgebieten; Anleitung zur GIS-basierten Herleitung der Inputparameter für das Geschiebeabschätzverfahren; Vorlagen der Hang-Beurteilungsmatrix und Gerinne-Beurteilungsmatrix des Geschiebeabschätzverfahrens
Monitoring von Feststofffrachten in schweizerischen Wildbächen (PDF, 564 kB, 07.04.2010)In "Wasser, Energie, Luft", Heft 1, 2010.
Ereignisanalyse der Hochwasser vom August 2005 in Bächen des Beobachtungsnetzes der GHO (PDF, 607 kB, 19.08.2009)Studie im Auftrag des BAFU, 2009
Die Anhänge zu dieser Studie sind zu beziehen über:
hydrologie@bafu.admin.ch
Abschätzung von ereignisbasierten Feststoffvolumina in Schweizer Wildbächen mit neuronalen Netzwerken (PDF, 3 MB, 31.05.2016)Masterarbeit von Jan Baumgartner, Universität Bern, 2016
Geomorphologische Auswirkungen von Geschiebesammlern auf den Unterlauf in Wildbächen (PDF, 8 MB, 31.05.2016)Eine Untersuchung an Geschiebesammlern der Datenbank Solid. Masterarbeit von Silvia Käser, Universität Bern, 2016.
Das Modell sedFlow und Erfahrungen aus Simulationen des Geschiebetransports in fünf Gebirgsflüssen der Schweiz (PDF, 19 MB, 03.06.2016)Synthesebericht der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, 2015.
Datenbank Solid - Konzeptoptimierung (PDF, 1 MB, 03.06.2016)Schlussbericht, Universität Bern, 2015. Im Auftrag des BAFU
Le document ci-dessous regroupe d'autres références bibliographiques sur ce thème. Les études et rapports correspondants sont disponibles sur demande à l'adresse hydrologie@bafu.admin.ch.
Dernière modification 14.10.2025