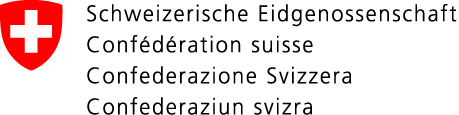Lors de la conférence sur le climat qui s’est tenue en 2015 à Paris, un nouvel accord, qui engage pour la première fois tous les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, a été adopté pour la période après 2020. L’ancienne distinction entre pays industrialisés et pays en développement a ainsi été largement supprimée.
L’Accord de Paris est un instrument juridiquement contraignant de la Convention-cadre sur les changements climatiques. Il est entré en vigueur le 5 octobre 2016, après avoir été ratifié par 55 États représentant au total au moins 55 % des émissions mondiales.
La Suisse a ratifié l’Accord de Paris le 6 octobre 2017. Ce faisant, elle s’est engagée à réduire de moitié d’ici à 2030 ses
émissions par rapport à 1990, en prenant en compte une partie des réductions d’émissions réalisées à l’étranger. De plus, elle a décidé de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à zéro net d’ici à 2050. Elle concrétise ses engagements internationaux en premier lieu dans la loi sur le CO2.
L’Accord de Paris comporte des éléments visant à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre par étapes successives et est basé pour la première fois sur des principes communs à tous les États.
Objectifs de l’Accord de Paris
L’Accord de Paris vise à contenir le réchauffement mondial moyen bien en dessous de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, l’objectif étant de limiter la hausse de la température à 1,5 °C. Il a également pour but d’axer les flux financiers sur un développement à faible émission de gaz à effet de serre et de renforcer la capacité d’adaptation aux changements climatiques.
Principes communs de l’Accord de Paris
- Tous les cinq ans, les États doivent communiquer un objectif de réduction des émissions déterminé au niveau national (Nationally Determined Contribution, NDC), dont la réalisation n’est contraignante qu’au plan politique. La mise en œuvre de mesures nationales ainsi que les rapports sur la réalisation de l’objectif et leur contrôle au niveau international sont néanmoins juridiquement contraignants.
- Les objectifs de réduction de tous les États doivent être clairs, compréhensibles et quantifiables. Les objectifs de réduction successifs fixés par chaque État doivent représenter chaque fois une progression par rapport à l’objectif antérieur et correspondre à un niveau d’ambition le plus élevé possible.
- Les réductions d’émissions réalisées à l’étranger peuvent être imputées à la réalisation de l’objectif dans le cadre de l’accord, pour autant qu’elles respectent l’intégrité de l’environnement, qu’elles contribuent au développement durable et qu’elles ne donnent pas lieu à un double comptage. L’Accord de Paris (art. 6) reconnaît deux types de réductions d’émissions réalisées à l’étranger (Internationally transferred mitigation outcomes, ITMOS), à savoir celles s’inscrivant dans le cadre d’un mécanisme établi par l’Accord de Paris et celles s’inscrivant dans des accords bilatéraux ou plurilatéraux (art. 6, par. 2).
- L’Accord de Paris met pratiquement fin à l’ancienne distinction stricte entre pays industrialisés et pays en développement. Il laisse les pays les plus pauvres décider de la mise en œuvre selon leur propre appréciation. Il encourage, en outre, les pays industrialisés à continuer de montrer la voie en se fixant des objectifs de réduction en chiffres absolus à l’échelle de toute l’économie. En contrepartie, les pays en développement sont également encouragés à définir peu à peu des objectifs à l’échelle de l’économie. La différenciation entre les États est dynamique : les objectifs de réduction sont définis à l’échelle nationale et doivent refléter le niveau d’ambition le plus élevé possible d’un État. L’objectif de réduction de chaque État correspond ainsi à l’évolution de sa responsabilité envers le climat et de ses capacités.
- En matière d’adaptation aux changements climatiques, tous les États doivent élaborer, présenter et actualiser régulièrement des stratégies et des mesures d’adaptation. Le moment et la forme de l’annonce au niveau international peuvent être déterminés au niveau national. De plus, les pays doivent faire régulièrement rapport sur les mesures d’adaptation réalisées. L’Accord de Paris renforce les mécanismes existants destinés à éviter et à diminuer les pertes et les dommages (loss and damage), la responsabilité civile et la compensation étant explicitement exclues.
- S’agissant du financement, l’Accord de Paris ne fixe pas d’obligations nouvelles. Les pays industrialisés sont toujours tenus d’aider les pays en développement à mettre en œuvre leurs propres mesures de réduction des émissions et d’adaptation. Pour la première fois, les pays non industrialisés y sont également invités. La mobilisation de moyens de financement provenant de sources publiques et privées est désormais l’affaire de tous. Les pays industrialisés devraient néanmoins continuer à montrer l’exemple. L’objectif commun des pays industrialisés de mobiliser 100 milliards de dollars de fonds publics et privés par an à partir de 2020 a été confirmé jusqu’en 2025, et un nouvel objectif similaire a été proposé pour la période postérieure à 2025. Les pays industrialisés sont donc toujours tenus de faire rapport tous les deux ans sur les ressources mobilisées en fournissant désormais, si possible, des informations quantitatives et qualitatives à caractère indicatif concernant les moyens prévus pour les années suivantes. Les règles y afférentes seront étoffées. Les pays en développement sont aussi encouragés à faire rapport tous les deux ans, non pas uniquement sur les moyens nécessaires et obtenus, mais également sur les investissements respectueux du climat et le financement climatique international qu’ils ont été en mesure de mobiliser.
La Suisse est en bonne voie pour mettre en œuvre l’Accord de Paris.
Les engagements de réduction pris conformément à l’Accord de Paris sont mis en œuvre dans la législation nationale sur le climat. La Suisse s’est fixé des objectifs de réduction d’émission conformes aux objectifs de l’Accord de Paris et aux recommandations de la science. Elle a communiqué en 2017 sa contribution volontaire déterminée au niveau national et a depuis renforcé son objectif.
Les objectifs de réduction d’émission de la Suisse au plan national
La Suisse a communiqué au niveau international ses objectifs de réduction d’émission. La contribution volontaire déterminée au niveau national est disponible sur le registre du Secrétariat de la CCNUCC:
En matière d'adaptation aux changements climatiques, le Conseil fédéral a approuvé, en vertu de la législation actuelle sur le CO2, une stratégie d'adaptation en deux volets pour la Suisse. La Suisse a transmis en 2020 sa communication sur l’adaptation, au titre de l’Accord de Paris.
La Suisse apporte une contribution appropriée aux 100 milliards de dollars par an requis à partir de 2020. Les ressources étatiques ont été principalement allouées à travers le crédit-cadre de la Suisse pour la coopération internationale (CI) pour la période 2017-2020 et une part plus faible sera sollicitée sur le crédit-cadre en faveur de l’environnement mondial pour la période 2018-2022. La Suisse élabore actuellement une stratégie afin de renforcer la mobilisation ciblée de fonds privés pour des actions de protection de l’environnement dans les pays en développement.
Informations complémentaires
Dernière modification 23.06.2023