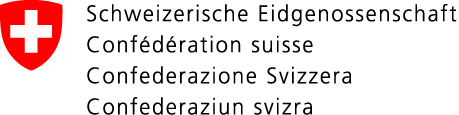En tant que Partie à la Convention sur la diversité biologique (CDB) et à nombre d’autres accords internationaux pertinents en la matière, la Suisse œuvre en faveur de conditions-cadre, de mesures et de politiques efficaces afin de maintenir, de développer et d’utiliser durablement la biodiversité.
Avec ses Protocoles de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, la CDB constitue l’accord le plus complet concernant la biodiversité. Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, et ses objectifs à atteindre d’ici à 2030 et 2050, a été adopté lors de la Conférence des Parties à la CDB de Montréal, en 2022.
Accords internationaux pertinents pour la biodiversité
Accords de portée mondiale : ils comptent notamment la CDB, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, la Convention internationale pour la protection des végétaux ainsi que la Commission baleinière internationale.
Accords de portée régionale : ils comptent notamment la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage et l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eaux migrateurs d’Afrique-Eurasie.
De plus, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Suisse participe activement aux négociations sur un accord de protection de la biodiversité hors des territoires nationaux (en haute mer).
Par ailleurs, la Suisse est membre de l’Union internationale pour la protection de la nature, de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, créée en 2012, et du Centre mondial d’information sur la diversité biologique
- 1. Convention sur la diversité biologique (CDB)
- 2. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
- 3. Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
- 4. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention sur les zones humides)
- 5. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn)
- 6. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)
- 7. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne)
- 8. Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ITPGRFA)
1. Convention sur la diversité biologique (CDB)
La CDB a été adoptée en 1992 à Rio de Janeiro lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement. Elle compte à ce jour 196 Parties. La Suisse l’a ratifiée le 21 novembre 1994.
Les Parties s’engagent à prendre les mesures appropriées pour protéger et exploiter durablement la diversité biologique ainsi qu’à régler de manière équitable l’accès aux ressources génétiques et l’utilisation durable de ces dernières.
La mise en œuvre de la CDB fait l'objet d'une surveillance et, si nécessaire, de décisions lors des conférences des Parties, qui se tiennent à intervalles réguliers. En avril 2002, les Parties à la CDB s’étaient engagées à parvenir, d’ici à 2010, à une réduction significative du rythme actuel de la perte de biodiversité. Lors de la Conférence des Parties qui s’est tenue à Nagoya en octobre 2010 ont été adoptés le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique à l’échelle mondiale ainsi que les objectifs d’Aichi correspondants. Malheureusement, à fin 2020, aucun de ces objectifs n’était entièrement atteint.
Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal
Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal a été adopté en décembre 2022 à Montréal lors de la 15e Conférence des Parties à la CDB et remplace le Plan stratégique. Ce nouveau cadre de référence contient des objectifs clairs et mesurables à atteindre d’ici à 2030 et 2050, assortis d’indicateurs uniformes qui ciblent les principales causes globales de la perte de biodiversité.
Il concrétise ainsi la mise en œuvre de la CDB et intègre également tous les accords et processus pertinents en la matière.
Ont en outre été adoptés à Montréal un mécanisme de compte rendu et de contrôle, ainsi que des mesures visant à mobiliser des moyens financiers en vue de l’atteinte des objectifs. Ce mécanisme de mise en œuvre renforcé doit permettre aux Parties de mieux évaluer le succès des mesures et d’en tirer des enseignements. Enfin, une décision a été prise au sujet du partage des avantages découlant de l’utilisation d’informations de séquençage numériques (digital sequence information, DSI), et un processus a été initié afin de créer un mécanisme multilatéral de partage des avantages.
Informations complémentaires : Official CBD Press Release, décembre 2022
Mise en œuvre nationale
Afin de maintenir la biodiversité à long terme, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication d’élaborer une stratégie nationale. Le 25 avril 2012, il a adopté la Stratégie Biodiversité Suisse, et, le 6 septembre 2017, le plan d’action correspondant. Ce dernier définit des mesures concrètes pour atteindre les dix objectifs stratégiques destinés à garantir la pérennité de la diversité biologique dans notre pays.
2. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques a été adopté en 2000 par les États Parties à la CDB. La Suisse l’a ratifié le 26 mars 2002. Ce protocole est un instrument de droit international traitant des aspects environnementaux et sanitaires de l’utilisation d’organismes vivants génétiquement modifiés. Il vise à assurer un degré adéquat de protection lors du transport et de l’utilisation d’organismes vivants, modifiés à l’aide de biotechnologies modernes, qui pourraient constituer une menace pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.
Le Protocole additionnelde Nagoya-Kuala Lumpur a été adopté à Nagoya en 2010. Il prévoit des règles et des procédures internationales régissant la responsabilité et la réparation en cas de dommages à la biodiversité causés par des organismes génétiquement modifiés. La Suisse l’a ratifié le 27 octobre 2014. Le Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur est entré en vigueur le 5 mars 2018. Ses dispositions rejoignent celles de la loi fédérale sur le génie génétique (RS 814.91).
CDB: Centre d’échange sur la prévention des risques biotechnologiques (CEPRB)
3. Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
Le Protocole de Nagoya, négocié dans le cadre de la CDB, régit l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Il vise ainsi la mise en œuvre du troisième objectif de la CDB et contribue à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments. Les ressources génétiques sont souvent associées aux savoirs traditionnels des communautés indigènes et locales. C’est pourquoi le Protocole de Nagoya intègre également des dispositions sur l’accès et le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces ressources.
Ratifié par la Suisse le 11 juillet 2014, le Protocole de Nagoya est entré en vigueur, pour cette dernière, le 12 octobre 2014. Sa mise en œuvre en Suisse a nécessité l’introduction de nouvelles dispositions dans la loi fédérale sur la protection du paysage et de la nature (LPN ; RS 451), elles aussi entrées en vigueur le 12 octobre 2014 (art. 23n à 23q, 24h, al. 3, et 25d LPN). L’ordonnance de Nagoya (RS 451.61), entrée en vigueur le 1er février 2016, concrétise les prescriptions relatives aux ressources génétiques dans la LPN et la mise en œuvre du Protocole de Nagoya en Suisse.
4. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention sur les zones humides)
La Convention sur les zones humides a été signée en 1971, à Ramsar (Iran). Il s’agit de l’une des plus anciennes conventions internationales dans le domaine de la protection de la nature. Elle est entrée en vigueur pour la Suisse le 16 mai 1976. Le siège de son secrétariat se trouve à Gland (VD).
5. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn)
Cette convention a été signée en 1979 à Bonn (Allemagne) et est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1995. Le siège de son secrétariat se trouve à Bonn.
6. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)
Aussi connue sous le nom de « Convention de Washington », la CITES a été signée à Washington en 1973. Elle est entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 1975. Le siège de son secrétariat se trouve à Genève. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires est l’autorité compétente pour la Suisse.
7. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne)
Cette convention a été conclue en 1979 à Berne, dans le cadre du Conseil de l’Europe. Il s’agit du premier accord sur la protection de la diversité biologique à l’échelle européene.
Son but est d’assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels ainsi que de promouvoir la coopération entre les États européens en matière de protection de la diversité biologique. La Convention de Berne accorde une attention particulière aux espèces menacées d’extinction et vulnérables. Elle met en œuvre, à l’échelon régional, de nombreux objectifs fixés au niveau international dans la CDB, adoptée en 1992.
8. Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ITPGRFA)
L’ITPGRFA a été signé à Rome en 2001 dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et est entré en vigueur pour la Suisse le 20 février 2005. L’Office fédéral de l’agriculture est l’autorité compétente pour la Suisse.
Informations complémentaires
Dernière modification 14.04.2023