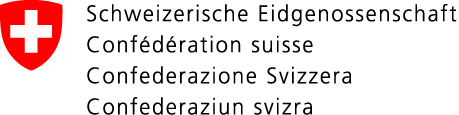Les mesures biologiques peuvent prévenir les processus dangereux ou diminuer le risques. La forêt protectrice est la principale mesure biologique, car elle protège localement des zones très étendues et représente une très grande superficie à l'échelle du pays. D'autres mesures consistent à modifier l'affectation du territoire, par exemple en créant des espaces naturels de rétention, en végétalisant des versants raides fortement érodés, ou en aménageant des versants ou des cours d'eau avec des mesures sylvicoles. Lorsque leur mise en œuvre est appropriée, elles sont réalisées en lieu et place de mesures techniques ou, si nécessaire, en combinaison avec elles.
Lorsque leur mise en œuvre est appropriée, les mesures biologiques remplacent les mesures techniques ou sont réalisées en combinaison avec elles.
Contrairement aux ouvrages de protection, les mesures biologiques ne sont pas toujours planifiées et réalisées de manière planifiée et ciblée. Par exemple, les forêts existantes ont également un rôle de protection contre les dangers naturels. Contrairement aux mesures techniques, l'homme peut certes contribuer aux mesures biologiques, mais il est lié aux processus naturels. En particulier, les mesures biologiques ne peuvent pas toujours être évaluées en termes d'objectifs de protection et ne fournissent donc éventuellement qu'une partie des prestations de protection nécessaires.
Pour déterminer l'efficacité des mesures biologiques de manière analogue à celle des mesures techniques, des méthodes adaptées aux propriétés des systèmes naturels doivent être appliquées. Certains principes de l'évaluation des effets des mesures de protection biologiques ont été élaborés dans le cadre du projet PROTECT Bio.
Etude de cas PROTECT BIO
• Pour les dangers naturels tels que les glissements de terrain superficiels et les chutes de pierres, l'approche PROTECT Bio a été utilisée pour étudier l'impact des forêts de protection sur deux tronçons du réseau ferroviaire des CFF. Les études de cas ont montré que la forêt protectrice a un effet positif considérable sur la protection des installations ferroviaires. La réduction des risques et le rapport coût-efficacité ont également été déterminés sur cette base.
• Une autre étude de cas sur l'évaluation de l'impact de la forêt de protection sur les avalanches a également pu démontrer une réduction importante du risque.
La méthodologie issue de ProtectBio de même que les résultats des études de cas seront intégrés dans le projet « PROTECT
Praxis », ceci afin de promouvoir un traitement uniforme de toutes les mesures de la GIR.
Forêts de protection
De nombreuses forêts offrent une protection efficace contre les dangers naturels gravitationnels tels que les avalanches, les chutes de pierres, les glissements de terrain et les laves torrentielles. Par ailleurs, les forêts situées sur des berges exposées peuvent empêcher ou réduire le risque d'obstruction des cours d'eau par du matériau meuble et du bois (forêts de protection liées aux cours d'eau). Une forêt de protection est une forêt qui permet de protéger un bien de valeur notable contre un danger naturel ou de réduire les risques que ce danger implique.

© Benjamin Lange, BAFU
Environ la moitié de la surface forestière suisse protège contre les dangers naturels. Pour que les forêts de protection puissent assurer leur fonction pleinement et à long terme, tout en s’adaptant au changement climatique, elles doivent faire l’objet d’une gestion durable. Leur entretien est une tâche commune de la Confédération, des cantons et des autres bénéficiaires.
Un effet protecteur à grande échelle
L'exploitation de plus en plus intensive des zones d'habitation et des zones industrielles, des voies de circulation et autres infrastructures a considérablement accru les enjeux au cours des dernières années. Cette évolution renforce l'importance des forêts de protection, au titre d'éléments de la gestion intégrée des risques. Les critères objectifs et concrets définis dans le cadre du projet SilvaProtect-CH de l'OFEV ont permis aux cantons de délimiter les surfaces des forêts de protection: à l'échelle de la Suisse, elles couvrent environ 6000 km2.
En tant que système de protection biologique, la forêt de protection joue un rôle particulier dans la prévention des dangers. Elle déploie des effets à grande échelle et protège simultanément contre différents types de dangers naturels. Lorsqu'elle est gérée selon une sylviculture proche de la nature, elle constitue de plus un milieu naturel pour de nombreuses espèces animales et végétales et favorise la biodiversité. Parallèlement, la forêt protectrice peut être exploitée pour son bois.
La protection, la biodiversité et la gestion sont des fonctions d’’intérêts publics. Elles sont indemnisées par l’intermédiaire de conventions-programmes entre la Confédération et les Cantons.
Soins aux forêts protectrices
La gestion durable doit permettre aux forêts de protection d'assurer leur fonction pleinement et à long terme, même lorsque les conditions climatiques changent. Les soins sylvicoles dont elles font l'objet correspondent à l'entretien périodique des mesures de protection. Grâce aux instructions du guide pratique « Gestion durable des forêts de protection » (NaiS), les cantons peuvent garantir des soins minimums. Ce document définit les exigences de qualité pour les soins aux forêts de protection.

© Benjamin Lange, BAFU
NaiS-LFI: Attribution des associations forestières pour les points d’échantillonnage de l’IFN
L'inventaire forestier national suisse (IFN) fournit de nombreuses données sur la forêt suisse. Dans le cadre d'un projet pluriannuel, des stations forestières ont été déterminées pour les 6357 points de l'échantillonnage de l'IFN en fonction des types de stations selon la nomenclature du NaiS (Gestion durable des forêts de protection). Les types de station NaiS de 2009 ont été mis à jour, développés et de nombreux ajustements ont été effectués : comme par exemple pour la classification dans d'autres nomenclatures des communautés forestières en Suisse. Cela sert de base pour les défis futurs auxquels la forêt suisse sera confrontée pour assurer la continuité de toutes les prestations forestières face au changement climatique.
Le rapport final présente à la fois la mise à jour des types des stations NaiS, la méthode d'attribution des stations forestières aux points d’échantillonnage de l'IFN, les résultats qui en découlent, ainsi que les applications possibles. Ces informations servent, entre autres, de base pour la mise à jour de l'aide à l’exécution de la « Gestion durable des forêts de protection » (NaiS).
Informations complémentaires
Liens
NaiS
Rapport final NaiS-LFI (PDF, 4 MB, 05.05.2021)(document en allemand)
Attribution provisoire des profils d'exigences (PDF, 178 kB, 14.02.2023)(document en allemand)
Annexes du classeur NaiS (fichiers PDF à télécharger)
2A. Détermination des types de stations (PDF, 22 MB, 03.11.2022)révisée et complétée; état en mars 2009
Video forêts de protection (FLV, 75 MB, 07.10.2011) – Forstmesse Lucerne 2011
Dernière modification 11.07.2023